Derrière la grille, le sujet
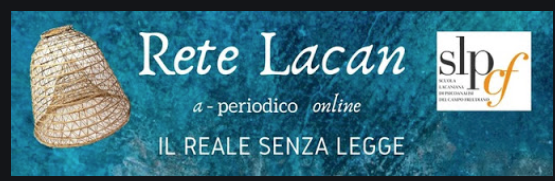
Entretien entre Sergio Caretto et Sebastiano Vinci
Sergio Caretto : Merci Sebastiano Vinci de cet entretien pour Rete Lacan1, revue électronique de la SLP qui se donne pour tâche d’explorer le réel qui, de temps en temps, frappe à notre porte avec tout son lot de désastres subjectifs et sociaux. Les portes que nous voudrions ouvrir aujourd’hui avec toi, compte tenu de l’importante expérience de clinique institutionnelle que tu as dans la ville de Palerme où tu vis et tu travailles, sont fondamentalement deux : psychiatrie et migration, en particulier l’accueil de mineurs étrangers non accompagnés. Que peux-tu nous dire, Sebastiano, de cette frontière de la Méditerranée qui met à profit ton expérience et ta formation psychanalytique ?
Sebastiano Vinci : Je saisis l’occasion de cet entretien pour faire une sorte de point de capiton par rapport à l’expérience professionnelle de ces années, pour la reprendre, et la revisiter afin que puisse se produire un nouveau sens et une nouvelle signification. Je voudrais d’abord dire que si je n’avais pas rencontré Lacan dans ma vie, je me serais trouvé vraiment très mal, et je n’aurais probablement pas eu la possibilité de travailler dans ces divers champs. L’enseignement le plus important que j’aie acquis dans ma rencontre avec la formation lacanienne est le respect du sujet. S’il s’agit d’une des conditions les plus simples qui soient requises dans notre domaine, rien ne dit qu’elles le soient ailleurs. Dans la réalité de la clinique psychiatrique, comme dans celle de l’accueil des sujets migrants, cette dimension éthique de l’attention au sujet est souvent inexistante dans la pratique de ceux qui exercent leur activité dans l’assistance, le traitement et le soin. C’est cette position qui m’a permis de « survivre » à dix ans de travail dans le domaine de l’«asile psychiatrique » et qui m’a orienté, comme un gouvernail, à me situer dans un contexte où on avait perdu le respect du sujet psychotique. Dans le centre résidentiel pour hommes où j’ai travaillé, il y avait aussi trois jeunes autistes, dont deux étaient nés en hôpital psychiatrique, de parents qui y étaient admis. La première fois que je suis entré dans ces services, je me souviens de ces grandes chambrées avec, au bout, une petite porte avec une grille d’où sortaient deux mains. J’ai demandé à qui appartenaient ces mains. Il s’agissait des mains de Nardo, un jeune garçon enfermé dans un petit jardin à l’intérieur du service, où il vivait nu, été comme hiver, parce qu’il était considéré comme un trouble pour l’institution, potentiellement violent. Je me rappelle encore les mains de Nardino me caressant, quand je décidai de mettre mes mains dans la grille. J’ai fait alors ouvrir la porte par des infirmiers, et ce très beau jeune homme est sorti, en trombe, se donnant de grands coups aux oreilles, hurlant à gorge déployée, mais sans pour autant rien faire tomber.
S.C. : « Qui est ce sujet fermé derrière la grille ? » Voici ce que veut dire avoir du respect pour le sujet : ne pas le réinsérer dans des catégorisations, mais lui donner la parole pour ce soit à lui-même de dire qui il est. Se tenir du côté du sujet, c’est alors se tenir du côté de l’inconscient, du sujet comme effet de dire.
S.V. : Oui, on retrouve ceci dans chaque domaine de mon expérience, aussi bien dans le champ du Centre public anti mobbing de Palerme, dont je suis responsable. Là aussi, où la dimension subjective peut sembler moins présente, en raison des diverses instances syndicales et politiques présentes, ce qui m’intéresse (je ne crois pas que le phénomène du mobbing ex-iste sinon comme effet de scénarios fantasmatiques subjectifs), c’est de faire surgir une demande subjective, au-delà de la simple demande de dédommagement matériel.
S.C : Partir donc du mobbing comme identification sociale universelle, pour faire émerger le sujet de la trame fantasmatique dans laquelle se situe sa singularité…
S.V. : Il suffit de le faire parler un peu pour que sortent les traits de répétition. Et la trame fantasmatique qui soutient et guide le sujet. Dans mon parcours, je m’estime chanceux d’avoir rencontré un psychothérapeute qui pratiquait le psychodrame analytique et qui m’a introduit ensuite à la psychanalyse lacanienne. Je me souviens encore, il y a des années de ça, à la section clinique de Rome quand, à la pause déjeuner, tous allaient manger, et que moi et quelques autres, nous faisions un cartel avec Virginio Baio. Aux collègues qui passaient et. nous lançaient : « Mais vous ne mangez pas ? » Virginio, en indiquant les livres, répondait : « Mais c’est ça notre nourriture ! » Baio a dit un jour : Lacan est comme la peste ! Si tu peux saisir la question du sujet au centre de l’analyse, alors tu te rends compte que c’est difficile de laisser Lacan. Je considère que j’ai de la chance de me trouver dans l’enseignement de Lacan en tant qu’on y fait l’expérience d’une clinique différente de toute autre clinique, justement parce qu’il vise le sujet de l’inconscient au-delà du lieu où nous rencontrons la personne, et des étiquettes qui voudraient la définir… Avec les « migrants » en particulier, on a souvent à faire à des sujets qui, en réalité, ne demandent rien, parce que souvent la possibilité d’une demande ne leur est pas donnée. Le défi est là : faire surgir une demande sans être invasifs, intrusifs, directifs ou violents ; c’est-à-dire sans utiliser des modalités qui malheureusement sont celles qu’ils ont souvent connues dans leur histoire : celles de la destruction du désir de l’autre.
S.C : Effectivement, Lacan précisait que la demande dépend de l’offre, de comment nous nous impliquons là où nous accueillons un sujet, dans les lieux les plus divers.
S.V : En partant aussi de la conviction qu’il n’y a pas de modalité standard. Chaque rencontre est un acte créatif qui répond au sujet que nous avons en face de nous, et qui peut produire une accroche pour l’autre, et de l’autre. Même si les récits des jeunes migrants peuvent apparaître semblables, il faut aller au-delà d’un possible standard pour chercher à saisir le chiffre singulier et unique du sujet.
S.C. : Puisque toute rencontre est création, nous ne pouvons alors pas en faire une technique standardisée… comment faire alors, Sebastiano, avec la demande toujours plus insistante à la clinique de traduire son expérience en techniques, questionnaires, protocoles ?
S.V. : Par rapport à cette demande toujours plus grande de techniques standardisées et de protocoles, je dois dire que je me sens heureusement inadapté! Cela me plaît de me trouver par rapport à ça un peu « à part », dans une veine un peu « révolutionnaire » qui, au fond, fait aussi partie de mon histoire.
S.C : Se tenir du côté du sujet veut alors aussi dire renoncer à toute forme d’adaptation du sujet à « nos » protocoles ou programmes. Se tenir du côté du sujet, comme nous l’enseigne la rencontre avec Nardino, veut aussi dire tolérer un certain degré d’inconfort lié à la différence entre l’un et l’autre, plutôt que de réprimer la singularité.
S.V : Réinsérer Nardino et les autres patients psychiatriques dans les murs et se limiter à faire un travail de contrôle est au fond plus simple en ce qu’il ne comporte aucune mise en question de la part du soignant. C’est différent d’assumer la responsabilité éthique de l’acte et de prendre en charge, de temps en temps, le sujet en question, position qui implique un certain inconfort et un effort qui, nécessairement, enveloppe l’inertie de certaines logiques institutionnelles sédimentées dans le temps. Il faut démontrer par sa propre présence que le patient n’est pas un numéro parmi d’autres, mais qu’il compte dans son absolue singularité.
S.C : L’acte subvertit donc la logique institutionnelle et demande une certaine dépense d’énergie de la part du clinicien, jusqu’aux plus petits gestes et détails du quotidien. À ton avis, quelles formes la ségrégation prend-elle aujourd’hui dans le champ psychiatrique ?
S.V : La ségrégation a changé les images et les semblants ; la violence de l’institution se présente aujourd’hui sous la forme de la disparition du sujet, sous la forme de l’absence de sa prise en charge. La ségrégation de la cellule d’isolement a disparu, le garçon nu dans le jardin n’existe plus, aujourd’hui, c’est plutôt dans l’anomie que sont actuellement traités les patients dans les services psychiatriques : la violence est toujours là, dans le fait qu’on ne respecte pas le sujet, qu’on ne l’écoute pas. Nous ne voyons plus aujourd’hui les scènes d’enfants autistes lavés à la pompe à eau et au balai, scènes qui font désormais partie de l’histoire de la psychiatrie, mais nous voyons des jeunes bourrés de médicaments, abandonnés à eux-mêmes, comme des robots, abandonnés sur un lit sans que personne ne se mette à côté d’eux. Dans ce sens, la violence a changé de forme, mais, au fond, elle est toujours la même. La psychiatrie a échoué sur ce point, à savoir qu’elle n’a pas été capable d’accueillir le fait que, dans la souffrance, ce n’est pas seulement un corps qui souffre, mais un parlêtre.
S.C : La logique que tu nous proposes est serrée : là où le sujet est exclu en tant que parlêtre et n’a pas son mot à dire, il ne reste que la gestion des corps réduits à leur statut de déchet à gérer. Ceci était valable hier comme aujourd’hui, il suffit de penser à la gestion des migrants qui sont considérés comme un problème à résoudre, dans le sens du lieu où placer les corps.
S.V : Oui, un problème à résoudre, par la « normalisation » et l’intégration » unilatérales : s’adapter à notre culture et à nos traditions sans rien vouloir savoir des leurs. L’accueil ne peut se réduire à ne fournir aux personnes qui arrivent sur nos côtes qu’à manger et dormir. Je pense à trois enfants, trois jeunes filles migrantes, arrivées avec une histoire de souffrance indicible : violence sexuelle, prostitution et atrocités en tout genre. Un jour, Hawa a raconté qu’une bande de guerriers libyens étaient entrés dans la case dans laquelle elle était hébergée, avaient violé sa mère et l’avaient brûlée, en mettant les restes dans un sac en plastique noir. La semaine d’après, les guerriers s’étaient présentés à nouveau dans la maison en violant aussi Hawa, qui avait alors 11 ans. Après quoi une opératrice de l’OIM (Organisation Internationale des Migrations) constatait que la jeune fille était enceinte. C’est à cette occasion qu’on m’a appelé et je me suis mis à parler avec la jeune fille pour envisager aussi la possibilité d’un avortement, ce qui signifiait aussi rouvrir la blessure des violences subies.
S.C : Là où le sujet rencontre des violences, et a vécu des choses si brutales et inénarrables au point de le laisser sans parole, cela, nous dis-tu, nous convoque à prendre la parole, afin que le sujet puisse, ne fût-ce qu’un instant, l’instant d’une rencontre, se raccrocher à l’autre et retrouver sa place, sa dignité de sujet. C’est là, entre l’un et l’autre, que surgit le sujet. Quand tu dis : ça m’a touché de parler avec Hawa, dans une situation si douloureuse, je trouve qu’une dimension éthique entre en jeu, liée à l’acte du clinicien.
S.V : C’est exactement ça, dans ma pratique avec les jeunes migrants, je me suis soudain rendu compte que je parlais, et que je parlais plus que je n’aurais « dû », selon l’idée reçue d’une formation théorique. J’étais là, avec ma présence, à l’écoute d’une souffrance qui ne trouvait pas les paroles pour pouvoir se dire. Cela me touchait cependant de dire quelque chose de plus, là où l’autre avait perdu l’existence de la parole.
S.C : Quand tu dis que tu t’es retrouvé à parler toi-même, et encore plus avec ces jeunes, j’ai pensé à ce que Lacan disait à propos de la rencontre avec l’enfant autiste, quand il affirmait que malgré le malentendu, il reste toujours « quelque chose à leur dire ». Là même où la parole semble ne pas avoir de mots en exercice, il s’agit de supposer toujours l’existence d’un sujet, en se souvenant de ce que dit Lacan dans le Séminaire III, Les psychoses, où il affirme que ce qui se passe pour un sujet dépend aussi de ce qui arrive au champ de l’Autre.
S.V : En prenant la parole, je cours un risque avec tout mon être.
Notes :
