Le virus du langage menace
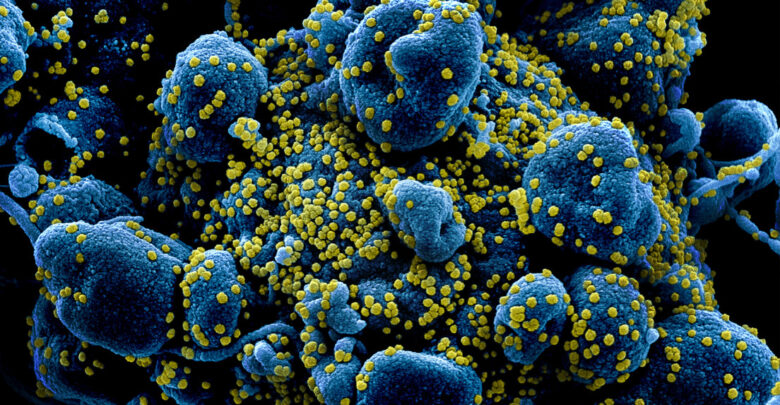
L’invitation du bureau de l’ASREEP-NLS à écrire pour son blog est une proposition bienvenue en temps d’affolement planétaire. Ce bref article parle d’infection langagière, ainsi que de son corrélat d’angoisse, et des traitements possibles avec les outils de la psychanalyse.
Dans un premier temps, j’avais choisi le signifiant « menace » parce qu’il peut se décliner dans une métonymie infinie, j’y reviendrai. Après une première lecture, je me suis décidée à y incorporer « virus du langage » parce que le virus que l’on traite n’est pas celui de la science, mais celui du langage qui comporte un autre type de virus, quand la menace surdéterminée peut devenir aussi inquiétante. Le seul virus que l’on peut parfois traiter est celui de la fuite du sens, l’objet perdu du langage, comme l’appelle Jacques-Alain Miller1.
Tout en reconnaissant que la menace est réelle (que le virus existe bel et bien), le mouvement s’oriente, premièrement, à intégrer la menace dans l’économie subjective du sujet. Qu’est-ce que cela veut dire ? On suppose que le sujet a quelque chose à dire sur la menace qui pèse sur lui, en déployant comme d’habitude ses signifiants propres, signifiants qui ne sont pas sans rapport avec ses symptômes. Mon hypothèse est qu’en se l’appropriant, d’une certaine manière, cette menace deviendrait moins écrasante puisque plus éloignée du sens commun mortifiant. Le sens binaire qui se réduit à avoir le coronavirus ou pas, etc. Comme dans notre pratique quotidienne, l’analyste peut s’appuyer sur sa voix et son regard, même à travers Skype ou le téléphone, la plupart de mes patients ayant trop peur de venir à la consultation, d’autres étant confinés ailleurs et ne pouvant pas traverser la frontière.
Ainsi quelqu’un me parlait de son hypocondrie pour décrire comment l’angoisse agrippe le corps. Il n’y a pas grand-chose à ajouter, simplement accueillir ses paroles avec bienveillance et garantir une présence sans inquiétude. Dire peut-être que ce n’est pas le bon moment pour arrêter de fumer, pour ne pas déchaîner encore plus le surmoi.
Une autre ne vient pas parce qu’elle veut « se protéger » et « me protéger ». J’acquiesce et lui laisse cette place de protection sans la questionner. Place qui lui donne une petite mission dans ce monde.
Il y a autant d’exemples que de sujets. Néanmoins, je voudrais m’arrêter sur un phénomène qui concerne la langue.
Métonymie de la menace
Plus haut, je parlais de métonymie pour décrire comment la menace se répand et infecte tout. D’abord, elle est centrée sur le coronavirus, elle passe très vite au porteur possible du virus et aux objets venus de l’extérieur, mais elle ne s’arrête pas là. Le pays de résidence ne protége pas assez et la langue de l’Autre n’offre aucune garantie, puisque susceptible d’être mensongère.
À ma grande surprise, la menace du virus, par un processus d’étayage, touche aussi à mon pays de résidence, la Suisse, qui ne prend pas les mesures qui s’imposent pour protéger toute sa population ou, dans une autre version, les citoyens étrangers (ceux que l’on appelle les expatriés) vont se sentir délaissés au profit des autochtones. Le pays d’origine apparaît ainsi bien plus protecteur, contre tout bon sens. Je décide de traiter cet envahissement par deux versants : le traditionnel, déjà mentionné, et en m’appuyant sur l’énonciation à travers la langue maternelle comme lien à une autre famille.
Nous savons, par de nombreux travaux cliniques dans notre champ, que la langue maternelle peut être persécutrice, la condition de possibilité d’une cure dans ces cas est qu’elle se déroule dans une langue étrangère.
Au contraire, les sujets que j’évoque (malheureusement, je ne peux pas ici donner plus de détails) trouvent une protection imaginaire dans ce lieu de l’Autre de la langue qui les a accueillis à leur naissance. Plutôt que ce que l’analyste a à dire, c’est l’énonciation de ce dernier qui peut faire point de capiton à la fuite de sens, comme déjà souligné plus haut.
Se faire le passage du témoin d’une langue à l’autre pour que le virus n’infecte pas tout serait la démarche choisie. Il est intéressant de constater qu’apprendre une langue c’est aussi accepter de se laisser infecter, parce qu’on ne retrouve jamais le même rapport jouissif à sa propre langue quand on incorpore une deuxième langue. Il y a l’expérience d’une perte. Mais cela nécessiterait un développement plus exhaustif.
La réalité évoquée ici peut être fantasmatique ou pas ; dans les deux cas, rien ne sert d’essayer de convaincre le sujet des bonnes intentions de la Suisse, mais il s’agit plutôt de border ce réel de la fuite de l’infection, en attendant que les choses se calment. Pour le dire d’une autre manière, rendre moins consistant cet étranger inquiétant, qui ne donne pas de garanties, en utilisant la langue partagée. Cette position d’accueil est la nôtre, mais en s’appuyant cette fois sur la langue commune et familière.
Nous avons souvent affaire à un Autre qui ne donne pas de garantie parce que son énonciation reste difficile à saisir. Difficulté qui n’est pas seulement méconnaissance de la langue. Par exemple, quelqu’un me disait la crainte qu’avait suscitée en lui le fait que les autorités suisses annoncent que le pays pouvait alimenter sa population pendant quatre mois. Dans ce cas, j’officie comme une sorte de traductrice en disant simplement qu’il fallait prendre cette information à la lettre, sans que cela n’annonce des pénuries alimentaires à venir.
Le discours de la transparence provoque cette méfiance parce que tout ne peut pas être dit, ce qui est non-dit revient comme la chose « cachée » potentiellement menaçante. Entre énoncé et énonciation, équivoque et malentendu… le flux ininterrompu des informations angoisse plutôt qu’il ne tranquillise. À nous de jouer.
Notes :
- Jacques-Alain Miller, « L’objet perdu du langage ». « Silet » (1994-1995). Texte paru en français dans The Lacanian Review 08, Nightmare.
