Une sexualité sans centre
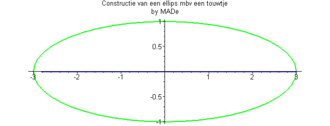
Freud considérait qu’il y avait eu trois grandes révolutions qui ont progressivement fait perdre à l’homme sa centralité. La première est la révolution copernicienne, et c’est celle qui nous intéresse pour notre argument. Avec grande prudence, Copernic a soutenu que dans le système héliocentrique, où le soleil devenait le centre de l’univers, il ne s’agissait que de simplifier les calculs, et il ne s’est pas engagé à s’exprimer sur la réalité vraie des choses. En fait, il n’a jamais encouru la colère de l’Église. Les effets concrets de la révolution copernicienne commencent plutôt avec Giordano Bruno, qui est immédiatement capable de tirer toutes les conséquences de la révolution scientifique de son temps, et avec son livre L’infini, l’univers et les mondes (De l’infinito universo e mondi), il nous représente l’extraordinaire fantasmagorie d’un univers sans points privilégiés, peuplés de systèmes solaires analogues au nôtre, où aucun astre dans l’espace infini n’est le centre. Bruno était moins disposé que Copernic à faire des compromis, et son histoire se termine au Campo dei Fiori.
Dire que le phallogocentrisme derridien a son propre point de départ en Giordano Bruno est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il ne fait aucun doute que sans le grand choc brunien sur la notion de centre, même le phallus et le logos n’auraient eu aucune possibilité de rétrograder de la première place à laquelle les événements humains les ont assignés.
On connaît l’histoire dans sa version classique : l’accès à la propriété du phallus introduit la norme du désir, du moins pour le masculin. Cependant, cette norme a été déconstruite par Lacan : du Nom-du-Père au père-vers, l’idée d’une norme du désir est consommée. S’ouvre l’horizon des modes de jouissance, une jouissance féminine est promise au-delà du phallus. Bref, il existe toute une gamme de concepts autour de la sexualité qui déstabilisent les équilibres maintenus jusque-là dans le monde patriarcal.
La théorie du genre, de Judith Butler, demande un pas de plus : elle veut transférer l’univers brunien au royaume de la sexualité, elle veut ouvrir le binaire homme-femme aux possibilités infinies de pratiques sexuelles qui échappent aux identifications sociales normatées, qui s’insinuent dans les failles de la machine distributrice des rôles ; elle veut profiter des écueils rencontrés pour créer des lignes de fuite de la norme permettant d’inventer des possibilités inédites.
On pourrait se demander : n’avions-nous pas déjà pour cela le terme de perversion ? Évidemment non, puisque la perversion implique une référence stricte à la norme dont elle s’écarte. De plus, le terme de perversion, qui au temps de Freud et dans le lexique analytique, était d’usage courant, a quitté le vocabulaire actuel, il n’est plus politiquement correct. À tel point que le DSM a pris soin de le remplacer par le terme de paraphilie, qui signifie une modalité d’amour collatérale, marginale. Le présupposé de cette définition, pourtant, est évidemment que, s’il y a marginalité, on suppose encore l’existence d’une ligne principale, un mainstream de l’amour, qui constitue le modèle de la normalité.
Comme la perversion, la paraphilie présuppose au fond une norme de laquelle on s’écarte. Cela n’a pas les mêmes résonances morales, mais cela ne change pas le cadre logique. Que pouvons-nous dire sur le genre ? S’il se produit en échappant à l’injonction sociale qui attribue les rôles, ne présuppose-t-il pas lui-même une norme à laquelle échapper ? Ne fait-il pas de la norme la condition de sa propre constitution ? En tout cas, si la perversion n’est plus un signifiant socialement actif, le genre a fait son chemin dans les profondeurs du goût et s’est progressivement imposé. Le genre est désormais un signifiant qui produit des effets dans la vie des gens, dans leurs choix, dans leur façon de penser. La clinique psychanalytique est un observatoire particulièrement privilégié dans ce sens.
Jusqu’à il y a une dizaine d’années, les personnes qui fréquentaient mon cabinet étaient des hommes, des femmes, des homosexuels. Je veux dire que chacun avait sa propre orientation, que ce soit bon ou pas pour le sujet qui s’en faisait porteur. Il y avait l’homme qui ne se sentait pas homme, parce qu’il avait des difficultés d’érection, ou parce qu’il ne pouvait pas s’imposer face à ses collègues, ou parce que sa femme le mettait sous sa coupe. Il y avait la femme qui se sentait un torchon (straccio), et qui, comme Dora devant la Madone de Raphaël à Dresde, passait des heures à parler avec admiration de ce qu’elle considérait comme un modèle de féminité inaccessible. Il y avait l’homosexuel qui n’osait pas sortir du placard, et qui vivait son inclination de manière conflictuelle : il n’avait aucune intention d’en changer, mais essayait seulement de ne pas en souffrir. Il y avait aussi l’homosexuel réalisé, qui n’avait aucun conflit avec son orientation sexuelle, et avait des problèmes d’un genre tout à fait différent. On parlait des homosexuels en analyse à l’époque à Nice, lors de la conférence franco-italienne des 22-23 mars 2003 sous le titre Des gays en analyse ? Sur ce sujet, nous avions des idées claires : un homosexuel ne vient pas en analyse pour guérir de l’homosexualité, mais il peut venir pour mille autres raisons. On parlait déjà des queers et des gender studies, Éric Laurent en avait beaucoup parlé, mais je ne pourrais pas dire que c’était déjà pour nous une réalité clinique. L’acronyme LGBT même n’avait commencé à circuler en Italie que vers l’année 2000, année où, sous l’impulsion de Franco Grillini, président de l’association Arcigay, a été organisée l’Europride pour la fierté gay (orgoglio gay). Bref, tous ces sujets étaient dans l’air du temps, mais n’étaient pas encore entrés dans la réalité de notre clinique.
Quelques années plus tard, en 2010, arrive sur mon bureau un livre intitulé Le corps sans qualité. Il m’arrive par une amie mariée à une féministe passionnée, et donc très familière avec ces thèmes. Archipel Quer, par Fabrizia Di Stefano, sociologue transsexuelle, lectrice attentive de Lacan. C’était peu après le scandale de Piero Marrazzo, président du Latium, surpris allant avec une voiture de service rencontrer un transsexuel. La presse en avait fait ses choux gras, on en avait parlé pendant une semaine, Marrazzo avait dû démissionner, et Fabrizia Di Stefano en avait parlé dans une interview intelligente, riche en références à Lacan. Dans sa perspective, le concept de queer apparaît comme diagonal à celui qu’elle considère comme deux catégories fondamentales du discours sexuel moderne : l’hétérosexualité et l’homosexualité. Le queer devient alors l’hétéron radical, irréductiblement nomade, qui développe une neo-hétérosexualité rhizomatique, non normée et non normative, ou au contraire, une néo-homosexualité basée sur la déconstruction de l’idée de genre. Avec toutes les résonances deleuziennes de sa prose, Fabrizia Di Stefano utilise évidemment le queer comme fer de lance pour percer le genre. C’est dans ces années- là, cependant, que quelque chose a commencé à changer dans la réception sociale de ces problèmes. Les références au queer et au genre ne sont plus seulement une question de débats intellectuels et politiques, mais elles commencent à entrer dans la tête des gens et, de là, arrivent dans nos cabinets. Dans les dernières années en effet se sont multipliés les patients qui se déclarent bisexuels, ou qui mènent de front une vie sexuelle nomade, et indifférente au sexe biologique du partenaire, ou qui changent d’orientation, même après une longue relation.
Au centre clinique de l’institut freudien, j’ai rencontré un jour un homme qui venait me parler car il avait été quitté par sa femme après plusieurs années de mariage. C’était un mariage sans conflits, de longue durée, traversé par la meilleure harmonie. Il avait rencontré sa femme à l’époque de l’école secondaire, et comme dans sa famille d’origine, il avait souffert des épreuves du couple de ses parents, il désirait une union sûre, solide, qui ne soit pas perturbée par le doute de désirs divergents. L’érotisme avec sa femme n’était pas somptueux, mais l’entente sentimentale était excellente et ne souffrait d’aucune faille. Jusqu’au jour où sa femme vient lui dire qu’elle doit le quitter parce qu’elle est tombée amoureuse de sa meilleure amie, et qu’il s’est rendu compte qu’elle était lesbienne.
On commence donc à ne plus se sentir coincé dans une orientation sexuelle particulière. Un jour, un patient souffrant d’homophobie sévère arrive en séance terrifié parce qu’il a entendu à la télévision un acteur célèbre affirmer qu’il s’était rendu compte qu’il ne se sentait plus intéressé par les femmes et qu’il avait développé des désirs homosexuels. « Pensez-vous que cela pourrait m’arriver aussi ? »me demande-t-il, profondément angoissé. Une patiente qui a vécu plusieurs années avec une autre femme commence à ressentir une diminution du désir de sa partenaire. En même temps, elle commence à voir les hommes avec des yeux différents, jusqu’à quitter sa partenaire pour partir vivre avec un jeune étudiant avec qui elle a une entente érotique satisfaisante.
Une autre patiente, au seuil de l’adolescence, a le sentiment qu’elle ne peut pas se situer. Elle se tient à l’écart des hommes, mais ne peut pas s’identifier à ce que font ses compagnes. Elle a l’impression d’être dans une zone neutre, suspendue, et cette suspension demeure jusqu’à ce qu’elle vienne me voir. Désormais, elle vit avec une femme, même sans avoir pris intérieurement une direction qui l’éloigne de sa neutralité protectrice.
Une jeune femme qui vient me voir parce qu’elle n’arrive pas à apaiser la colère en elle, dont la mère est le déclencheur, vient de se séparer de son mari, et me dit aussitôt qu’elle est bisexuelle, et qu’elle n’a aucune restriction en matière de choix du prochain partenaire.
Au moment précisément où la perversion disparaît du panorama des signifiants socialement utilisables, genre, queer, nomadisme sexuel, liberté de choix en matière érotique, ont pris le large, se sont imposés, ont créé de nouveaux sillons dans lesquels les gens entrent et insèrent leur vie.
Je dirais qu’il n’est pas difficile de voir que ce sont des refuges, des échappatoires, la possibilité d’une île, dirait Houellebecq, des lieux imaginaires où trouver refuge pour les exilés du rapport sexuel. C’est la femme qui vit avec une femme parce que cela la rassure de la peur de la violence masculine. C’est celle qui, se laissant aller telle un planeur sans pouvoir atterrir nulle part, diffère indéfiniment le prix du choix sexuel. C’est l’homme qui, tourmenté par l’homosexualité inconsciente, se remparde dans le bastion homophobe et regarde extatique la femme du désir recevoir le phallus de l’autre homme et se fait écran ou médiation pour l’objet refoulé de ses désirs. C’est le garçon qui a eu des relations homosexuelles avec son frère dans son jeune âge, et qui ne peut être excité que s’il s’imagine être la femme avec laquelle il est au lit, tout en recevant le phallus d’un autre homme. Ces fantasmes, qui sont assurément classiques, se trouvent débarrassés d’un imaginaire social qui en fait des styles de vie, ou des lieux de blocage dans le parcours de vie.
Il n’est pas nécessaire de chercher la théâtralisation du sexe qui devient politique, revendication, aspiration, militantisme pour voir ce qui apparaît dans notre clinique de manière moins exposée, mais plus labyrinthique : le nomadisme de l’identité sexuelle comme masque ou comme tentative de solution à l’absence du rapport sexuel. L’apparente infinité des voies est la cosmétique du passage étroit que nous devons tous traverser, celui de l’absence du rapport sexuel. Je crois qu’il y a deux niveaux sur lesquels se pose la question du genre. L’un est celui des droits civils. Les émeutes de Stonewall de 1969 sont le début du mouvement pour la reconnaissance des droits des homosexuels. Cela doit être une route sans retour possible, et extensible à toute la variété LGBT, avec les ajouts ultérieurs, LGBTQ, LGBTQI etc… Il s’agit évidemment d’une liste ouverte en permanence.
Freud a toujours été très lucide à cet égard : quand Ernest Jones a reçu de l’association psychanalytique néerlandaise la demande d’adhésion d’un médecin connu pour son activité homosexuelle manifeste, et, dans le doute, en a adressé la demande à Freud, la réponse de celui-ci était claire : l’homosexualité doit être considérée comme un facteur neutre pour l’évaluation des candidats. Nous savons que l’IPA a pris alors une direction différente, et qu’en particulier, des analystes de premier plan, tels qu’Anna Freud et Edmund Bergler, considéraient l’homosexualité comme une pathologie qui pouvait et devait être guérie. L’interdiction faite aux candidats homosexuels à l’IPA est restée jusqu’au coming out de certains analystes homosexuels qui ont dû cacher leur orientation pour devenir membres : Ralph Roughton se démarque parmi ceux-ci.
Sur le plan clinique, on peut au contraire reconnaître les différents déguisements imaginaires, les masques de l’absence de rapport sexuel, et je crois que le critère que Lacan énonce dans ses conférences américaines doit s’appliquer à nous : l’analyse se termine là où le patient trouve sa propre satisfaction. Contrairement à Anna Freud et à Bergler, nous ne voulons pas guérir les homosexuels de l’homosexualité, et par extension, nous ne voulons pas distraire les variétés LGBT de leurs modes spécifiques de satisfaction. La pratique de la psychanalyse va à l’encontre de la pratique des identifications, et il s’agit de faire vaciller les signifiants maîtres dans lesquels ces identifications collectivisent une jouissance, en elle-même réfractaire à toute universalisation. L’équilibre à trouver est celui qui permet de ne pas tomber dans l’illusion qu’un droit social est un droit à la jouissance, car la jouissance, Lacan nous le rappelle, n’est pas une question qui se pose sur le plan de la justice distributive.
Milan, le 31 mars 2021, traduction Violaine Clément 29 avril 2021.
