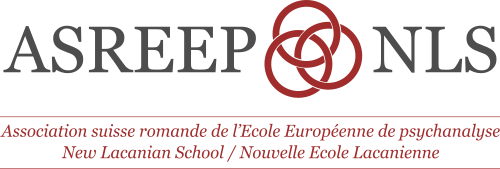Un drôle de juge « L’homme à trois poils »

Conversation avec Marc Boivin, le 13 mai 2025.
Marc Boivin1 est Juge cantonal à Fribourg. Nous nous croisons dans la rue où j’ai mon cabinet, ce qui a permis cette conversation pour notre blog. Je l’en remercie. Humoriste aux Dicodeurs, dandy au chapeau, créateur de plusieurs spectacles, il est l’auteur de plusieurs ouvrages. Il sera à Morges sur les Quais en septembre 2025.
Violaine Clément : Marc Boivin, vous êtes juge et humoriste, ce n’est quand même pas rien de lire deux choses aussi contradictoires. Un juge n’a pas vocation à faire rire. Expliquez-moi comment vous êtes tombé dans ces deux marmites. Pas comme Obélix, quand même, non ?
Marc Boivin : Non, ou alors j’ai fait un effort pour perdre un peu de poids (rires). Non ! Il y a un parcours assez classique dans une famille bourgeoise de la deuxième génération. Mes grands-parents étaient, plus ou moins, au mieux dans le secteur secondaire. Mon père, ma mère aussi, d’ailleurs, ne nous ont pas transmis la passion scientifique. Ni mon frère ni moi n’étions de grands scientifiques. On savait qu’on allait probablement continuer les études, mais en tout cas pas vers la science. Il restait donc pour moi deux pistes, l’une que j’adorais, la littérature : j’ai toujours aimé lire ; mais j’avais compris qu’il n’y avait pas beaucoup de débouchés, et que si j’allais à l’université, j’allais devoir subir les interprétations des profs qui, à mon avis, étaient en décalage complet avec les fulgurances des auteurs qu’ils étudiaient. Je n’ai donc pas pris la voie de la littérature à l’université, mais celle du droit. Je ne voyais pas tout à fait ce que ça allait être, mais j’ai suivi, par paresse, en étant conscient qu’il allait falloir subir une initiation. Parce que si je prenais les bouquins de droit pour me former tout seul, je ferais tout à l’envers. J’ai donc fait du droit, mais à mi-temps. J’ai toujours été un gars du mi-temps, et le reste du temps, je bouquinais, et j’alimentais ma cinéphilie, qui est même à l’origine de ma soif de littérature. J’étais donc déjà sur ces deux voies.
V.C. : Comme un Romain ! Les Romains étudiaient le droit, comme Cicéron, et pouvaient par ailleurs avoir une vie d’otium. Vous aviez le goût de la littérature…
M.B. : D’accord ! Mon goût allait vers la langue, les jeux de mots, l’humour, évidemment.
V.C. : C’est par la langue que vous êtes allés vers l’humour ?
M.B. : Non ! je n’étais pas encore en état de comprendre ce que je disais, que je pouvais faire rire. J’ai compris vers l’âge de quatre ans que si je restituais ce qui m’était véritablement arrivé, j’avais un rapport avec les adultes normal, mais pas forcément satisfaisant, mais que si je procédais au petit décalage comique, je provoquais très vite les rires. Je me nourrissais des rires. J’adore entendre les gens rire. Depuis petit, il y avait beaucoup de rires dans ma maison. le rire, c’est la musique de l’humanité.
V.C. : « C’est bon pour la santé2! »
M.B. : Pour moi, c’est plus que ça, c’est une philosophie de vie. Je décode les gens avec le rire avant de faire une analyse intellectuelle des gens que je rencontre, même sur mon lieu professionnel, même avec les gens que je ne connais pas. Je pratique l’humour, la dérision, plutôt constructive, l’auto-dérision : je n’ai pas un humour assassin.
V.C. : Vous avez un humour avec, pas contre…
M.B. : J’ai un humour avec, toujours. Et j’ai besoin de créer un petit monde parallèle de rire pour que les gens se sentent bien, et je peux les décoder très facilement. J’ai donc développé ces deux passions. Et l’humour, avec son regard décalé, correspond aussi au regard décalé du juge, c’est le même travail. L’humour m’aide beaucoup dans mon métier, dans mes relations avec mes greffiers et mes greffières, mes collègues, notre secrétariat, ou même en séance. Pour voir ce qui se passe. Parce que la séance, en pénal, c’est pour le prévenu qu’on l’organise, ce n’est pas le procès de la victime, ni du ministère public, qui vient pour requérir dans l’intérêt de la société. Mais c’est véritablement le prévenu qui, même s’il est un agresseur par rapport à la victime, est toujours beaucoup plus petit que l’État. Il est tout petit quand il vient. Les victimes ont parfois tendance à l’oublier. Quand on dit : In dubio pro reo, ce n’est pas pour créer une inégalité entre l’agresseur et la victime, qui sont dans un autre rapport, un rapport privé, c’est pour rééquilibrer le gros désavantage qu’il y a à affronter tout seul l’appareil de la justice. J’ai donc besoin, comme c’est son procès à lui, de voir comment il réfléchit, comment il raisonne, s’il a du recul, de voir s’il est capable de s’abstraire de la réalité des faits qui le mènent à moi, et comment il le fait, au premier degré, au second degré, et puis je peux d’emblée avoir le regard du prévenu et adapter ma séance en fonction de lui. Je ne suis pas un juge qui arrive avec des principes et une gestion systématique, toujours la même, de la séance.
V.C. : Vous considérez la singularité.
M.B. : Toujours ! L’humour est simplement un excellent test, un gentil test, en plus, pour voir si j’ai la personne avec moi ou si elle est dans un autre monde, si elle est en empathie, ou en manque d’empathie. Et ça nous donne des perspectives plus précises pour faire le travail qu’on attend de nous : fixer la peine.
V.C. : On va avoir cet automne à Paris un congrès qui s’intitule : Comique dans la clinique. C’est aussi très intéressant (c’est le même travail !) et, comme le disait Freud, pour rire ensemble, il faut être de la même paroisse. On ne peut pas rire avec n’importe qui, disait Coluche…
M.B. : C’était Desproges qui disait ça et il faut tordre le cou à cette phrase que nombre de comiques ânonnent sans véritablement y penser. Ça fait très longtemps que je n’utilise pour ma part plus cette phrase.
V.C. : J’ai pourtant cette idée-là de faire attention avec qui je ris. Parce que parfois, même quand je ne veux pas rire, l’autre peut prendre ça comme une insulte, comme de l’ironie. Différencier l’humour de l’ironie, c’est ce que vous appelez l’humour gentil.
M.B. : Oui ! Moi je suis aussi un ironique, mais simplement, je ne vais pas adapter mon humour : je vais tirer le premier, comme on dit, mais gentiment, pour voir comment ça réagit. Et en fonction de la réaction, je vais laisser tomber, ou aller plus loin. Je ne vais pas anticiper le ressenti de l’autre. Je suis assez ferme là-dessus, et ça fait partie aussi de mon travail : on doit sentir les choses, mais on doit aussi toujours vérifier la qualité de l’humour, non pas par rapport au ressenti du récepteur, mais par rapport à la qualité de l’intention de l’émetteur. C’est là que ça se juge,
V.C. : Oui, mais c’est difficile de juger l’intention de l’émetteur.
M.B. : Oui, c’est un peu présomptueux de ma part, mais avec ma double, triple formation et au fond de moi, je pense vraiment que je ne suis pas un nuisible pour la société. Je sais que le fond est toujours bon.
V.C. : Ah ? Vous y croyez ?
M.B. : Moi je pense que oui, je ne pratique pas, en tout cas dans l’échange quotidien, l’humour fondé sur une critique de la personne que j’ai en face de moi, que ce soit sous l’angle vestimentaire, sous l’angle de l’apparence, sous l’angle de la race, sous l’angle de de la culture. Non, je ne fais jamais ça ! C’est plutôt un humour abstrait, j’aime bien dire anglo-bruxellois (un peu classe, quoi !), plutôt absurde, pas forcément classe. L’absurde n’a pas vocation à blesser les gens. Il peut importuner les personnes qui ne comprennent pas l’absurde, et donc qui, parce qu’ils ont des phases de vie difficiles, vont mal le percevoir. Mais moi, ça ne me pose pas trop de souci que ces personnes-là le perçoivent mal, j’arrêterai, simplement, mais il n’y aura pas de lien de causalité entre cette façon débonnaire, sympathique et un peu anglo-saxonne d’être, déconnante aussi, et une personne qui prendra tout mal.
V.C. : Vous disiez tout à l’heure que vous vérifiiez si le prévenu est dans le même monde. Vous pouvez en dire un peu plus ?
M.B. : Là, on fera la part des choses entre ma vie intime, où le même monde correspond un peu à ce que vous disiez de Freud : on est dans la même paroisse. Il faut regarder si ces personnes sont compatibles : on va vivre, on va manger… Si elles ne le sont pas, je ne vais pas plus loin dans la relation, ça ne m’intéresse pas, j’ai tellement d’amis, je n’ai pas besoin d’aller manger avec mes ennemis ou avec des gens qui ne comprennent pas ma manière d’être, ma manière de vivre en société. Par contre, comme juge, je dois plutôt essayer de voir la sensibilité du prévenu par rapport à ce qu’on attend de lui, c’est-à-dire la logique de l’appareil judiciaire. C’est la « paroisse judiciaire », dirais-je, qui est censée s’appliquer à tous.
V.C. : Quand j’entends cela, je me dis qu’il y a quelque chose comme d’un diagnostic, même si un psychanalyste ne fait pas de diagnostic. Moi je reçois quelqu’un …
M.B. : C’est pour ça que je suis venu chez vous ! (rires)
V.C. : … dans une fraternité discrète, le mot est assez joli, je trouve (bien sûr !). Et puis j’essaie de voir dans quelle mesure il va m’accepter, et si moi je vais l’accepter…
M.B. : Il y a déjà un début de contrat, entre vous…
V.C. : … toujours ! Quand quelqu’un débarque chez moi, il doit pouvoir s’assurer que je ne vais pas aller hurler sur la place publique ce qu’il vient de me dire.
M.B. : Vous avez le même rapport à peu près que celui que j’ai pu avoir dans la période importante de ma vie initiatique en droit, alors que j’étais avocat stagiaire. C’est le même type de confiance, ce sont des liens de confiance, des contrats de confiance, de fideis en fait. Souvent, la confiance se matérialise sous la forme juridique du mandat, avec des obligations du mandant et du mandataire.
V.C. : Sauf que, de façon intéressante, quand on est psychologue ou psychiatre, on peut être délié du secret. Mais moi, je n’ai pas à être déliée du secret, puisque j’ai à considérer le secret comme quelque chose qui importe au travail que je fais.
M.B. : Vous pourriez l’être, si vous étiez psychiatre forensique. À ce moment-là, vous fonctionneriez en tant qu’expert, mais si on vous demandait votre avis en tant que spécialiste, ce qui n’est pas la même chose qu’expert, vous pourriez être déliée de votre secret par votre patient, si effectivement vous étiez amenée, même sans poser de diagnostic, à aider la justice dans sa recherche, sinon de la vérité, du moins de la juste personnalité de l’auteur qu’on s’apprête à juger. Et il peut y avoir des circonstances atténuantes, en lien avec ce diagnostic, ne serait-ce qu’une diminution de la responsabilité pénale, par exemple.
V.C. : Je peux en effet être amenée à… mais ce que je trouve intriguant, c’est que ce n’est pas quelqu’un d’autre qui peut me libérer du lien que j’ai contracté, puisqu’il s’agit de ma décision, singulière. Par chance, n’étant ni psychiatre ni psychologue, je ne suis pas tenue par une confrérie. Dans votre cas à vous, je vous entends être vraiment sensible à la différence entre un schizophrène et un bon névrosé (Ah oui !). Comment vous savez ça ?
M.B. : Alors, il faut savoir une chose : maintenant, je suis dans le pénal, depuis quelques années, mais historiquement, ma grande spécialité, que j’exerce toujours au Tribunal cantonal en dirigeant la première cour sociale, ce sont les assurances sociales. C’est l’AI (assurance invalidité), l’assurance-accident… Forcément, j’ai lu beaucoup plus d’expertises psychiatriques que mes confrères pénalistes, en vingt-cinq ans. En ayant beaucoup lu ces rapports, quand j’en avais le temps, je me suis rendu compte qu’un être normalement constitué doit avoir en lui, en doses homéopathiques, tous les traits de toutes les maladies psychiatriques qui existent (rires), qui peuvent être incarnées en lui pour former une juste dose. C’est une question de mesure. On devrait tous avoir tous ces penchants-là.
V.C. : Lacan le disait : la folie est le propre de l’homme.
M.B. : C’est ça ! Je dirais : la folie, c’est le propre non maîtrisé de l’homme. On a tous une part de folie, maîtrisée. Jusqu’où peut-on la maîtriser ? J’ai beaucoup lu sur ces choses-là. Dans la littérature, on est amené à croiser le destin de nombreux personnages. Les personnages les plus intéressants sont ceux qui ont des névroses ou des psychoses.
V.C. : Vous êtes d’accord, ils sont bien plus intéressants…
M.B. : On pourrait créer ensemble, là, au moment où on en parle, le paradoxe Tintin : Tintin est le seul personnage équilibré (rires), qui n’a aucune névrose ni rien, mais qui est absolument inintéressant. Et puis il y a tous les personnages névrotiques ou schizos autour de lui, d’une manière ou d’une autre… Vous avez vu lors de notre spectacle3Tournesol, le prix Nobel (Didier Queloz) le dit bien. C’est la surdité, en fait elle est factice, sujette à gag, qui crée chez Hervé cet intellectuel un homme un peu perdu dans ses recherches, et atteint d’une forme de surdité à ce qui l’entoure… Sa folie est liée à la surdité. Haddock, c’est l’alcoolisme. Pour les Dupondt (orthographe choisie par Hergé !), alors là, c’est une espèce de gémellité trouble, on va dire, humoristique : l’humour bruxellois d’Hergé excelle dans ces instants.
V.C. : … et la Castafiore !
M.B. : Ah, bien sûr, la Castafiore, c’est encore une autre forme de narcissisme, histrionique.
V.C. : La Comédie humaine, comme vous la voyez dans votre tribunal !
M.B. : Absolument ! Je dis toujours que le tribunal est un prétoire de vie4. Et c’est pour ça que quand j’ai un jeune homme, comme l’autre jour, qui est atteint de troubles qu’on peut associer à la schizophrénie au sens large du terme, je pars du principe que c’est un malade. Donc s’il déconne, s’il interrompt l’expert, s’il parle avec son avocat pendant le truc, et que ça dérange le ministère public, je vais dire au ministère public : Écoutez, vous êtes gentil, mais c’est ma séance, mon procès-verbal, et moi, ça ne me dérange pas… L’affaire est classée.
V.C. : Vous refusez donc de punir quelqu’un juste parce qu’il est fou ?
M.B. : je ne veux pas être trop critique par rapport à l’avis que certaines personnes peuvent avoir de ma gestion de la séance de pénal. Mais quand je gère ma séance, je n’ai encore puni personne. Ainsi le prévenu de l’autre jour, je ne l’ai pas encore jugé, alors je ne vais pas être agressif avec un prévenu. Je le jugerai plus tard, mais dans la séance, il n’est pas encore condamné.
V.C. : Il pourrait sortir libre…
M.B. : Il pourrait sortir libre, sauf s’il a reconnu les faits, évidemment. Mais en attendant, je ne vais pas le blâmer. J’ai eu à donner une fois un jugement expliqué par oral. C’était une affaire dont on a parlé dans la presse, d’une personne qui est arrivée libre et qui a pris douze ans, douze ans de prison le soir même. Mais quand je lui ai expliqué que son recours était rejeté, et la gravité des faits, je ne l’ai pas accablé. Je lui ai dit, en évitant d’user d’adjectifs : Vous avez très bien compris pourquoi vous êtes là. La vérité, c’est les faits que vous avez commis. Mais je ne vais pas encore lui dire : Vous êtes une mauvaise personne ! Ça ne m’intéresse pas (Pas besoin de le fesser !). C’est inefficace, de toute façon, c’est inaudible pour lui. J’ai lu le psychologue Daniel Kahneman, qui dit que ça ne sert à rien de gueuler sur les gens. Ils ne vont pas s’améliorer parce qu’on leur crie dessus (rire).
V.C. : J’aime bien cette idée d’inaudible. Quand on parle, quand on fait du bruit avec la bouche, on ne sait pas du tour ce qui va résonner dans l’oreille de l’autre. C’est dans les petits cailloux de l’oreille interne que quelque chose va résonner, mais dans le langage de celui qui entend. C’est la question de la parole. Dans le comique, dans le jugement, dans la littérature, l’écrit, c’est encore autre chose, la parole est au cœur de tout ce qui vous fait vivre.
M.B. : La parole ET l’écrit quand même (Ou : la parole est l’écrit, ou la parole elle écrit ?). C’est mes deux standards. D’ailleurs, j’ai beaucoup réfléchi à la manière de retranscrire une parole, à la manière de travailler sur le gag, et sur le gag notamment en courT(s). Je dois travailler justement à enlever, enlever, enlever, pour arriver à ce qui apparaît finalement, à ce qui pourrait s’apparenter le plus à une parole spontanée, rapide, comme une flèche, qui va attendre sa cible.
V.C. : Il faut beaucoup travailler pour faire une flèche !
M.B. : Ah, il faut la tailler ! Une phrase, comme je fais beaucoup d’aphorismes, à la manière des moralistes du XVIIème, en dessous de trois mots, je n’y arrive pas ! (rires)
V.C. : Ce sont des haïkus !
M.B. : En dessous de trois mots, on ne peut pas faire de gag à mon avis ! Un oxymore, peut-être… Mais alors, il faudra enlever le pronom, l’article. Mais pour qu’un oxymore soit drôle, pour qu’il soit situé dans un contexte, la description du contexte, du décor, requerrait à mon avis l’usage d’un autre mot. Donc je ne pense pas que ce soit possible en dessous de trois mots. Voilà, pour dire : la parole, mais l’écrit aussi !
V.C. : Depuis des années, on travaille à Fribourg, dans un laboratoire du CIEN, sur ce qui de l’inconscient s’écrit (c’est cri…), mais actuellement, dans notre champ, on ne parle plus d’inconscient. Lacan, avec Joyce, a parlé de parlêtre5, qui entre dans le discours public, comme le corps parlant. Vous êtes un parlêtre sur pattes, un homme parlant ambulant…
M.B. : … un griot !
V.C. : N’est pas Sénégalais qui veut ! (rire) J’aime beaucoup ces griots, qui sont aussi ceux qu’on envoie pour demander une femme en mariage…
M.B. : … La parole crée la société, vous êtes mieux placée que moi pour le savoir. Ces mères, victimes de guerre, qui arrivent avec un enfant en bas âge, qui ont perdu leur mari, qui n’ont plus la force d’adresser la parole à leur enfant, sans le vouloir, vont créer des dégâts qui seront irréversibles. La parole apaise la colère, comme disait… je crois bien que c’est Eschyle (juste ! trop fort, le juge !)…
V.C. : Ce que je trouve formidable dans cette question de la parole, c’est la question de l’insulte, dont parle ce collègue dont je vous enverrai le texte6… C’est vrai que si une maman dit à son petit enfant mon petit salopard, tout dépend du ton, et il entend d’abord le ton…
M.B. : Bien sûr ! Alors ça, c’est la contextualisation de la parole, qui fait aussi la musique. C’est pour ça que je dis que j’aime bien entendre le rire des gens, parce qu’on voit si le rire est méchant, s’il est agressif, s’il est heureux (s’il est gras). On voit l’intelligence des gens à leur rire.
V.C. : Et l’intelligence, ça compte, pour vous ?
M.B. : Pour moi, alors ça va paraître très très élitaire, ce que je vais dire, mais effectivement, l’intelligence, qui n’est pas forcément une intelligence universitaire, est fondamentale dans le rapport à autrui.
V.C. : On appellera ça alors l’intelligence du cœur ?
M.B. : L’intelligence du cœur, je m’en méfie beaucoup. Je me méfie de l’idée préconçue, et fausse, que le cœur serait supérieur à la raison. Je privilégie toujours la raison (la réson ?) par rapport au cœur, dans la manière de s’adresser à l’autre. Je pense qu’un être de raison, qui a quand même des qualités de cœur, sera plus capable de générer de l’amour qu’un être de cœur, incapable de maîtriser ses sentiments, et qui peut être extrêmement négatif. Donc l’intelligence du cœur… je ne suis pas sûre que le cœur soit intelligent (rire). Je pense que le cœur est con, et que c’est le cerveau qui est censé être intelligent.
V.C. : C’est le thème de notre congrès du week-end passé : Amours douloureuses ! Lacan disait que quand on veut faire un par amour avec quelqu’un, on le crève.
M.B. : Ça, ce ne sont pas les amours douloureuses, ce sont les amours délétères, ou dysfonctionnelles. Et puis, qu’est-ce que l’amour ? Question magnifique ! Il est souffrance dans son antichambre, parce que quand on aime et qu’on n’est pas sûr d’être aimé en retour, on souffre. Il va être feu joyeux, mais le feu, ça brûle aussi ! Il y aura toujours des phases maniaco-dépressives des premiers temps, et après, il peut encore changer, parce qu’il peut devenir ennui, répétition, et après, quand il disparaît, il est souffrance du souvenir. Il n’y a pas d’amour heureux, je crois que c’est Aragon qui disait ça (Juste encore !).
V.C. : Le seul moment heureux serait alors dans les escaliers quand on suit la femme…
M.B. : Oui, je ne sais plus qui dit ça, Casanova ? (C’est Clémenceau) Il y a le premier baiser volé, et après, c’est fini, l’aventure s’arrête. Mais l’amour, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi le partage, la somme de l’amitié et de l’humour. J’aime bien ça, je ne considère pas l’amitié sans humour.
V.C. : Plutôt l’humour que l’amour ? Un homme qui fait rire est un homme qui a gagné.
M.B. : Alors, c’est aussi un homme qui fait gagner ses copains. Parce que quand on est jeune, et qu’on fait beaucoup rire, je l’ai vécu, je le dis encore aujourd’hui, l’amour (Joli lapsus pour l’humour) est apparemment un facilitateur dans la chose amoureuse, parce que ça génère une sorte de charme, aussi. Mais quand la femme – là, je suis obligé d’avoir une vision hétérosexuelle et centrée, parce que je suis hétérosexuel, et mon expérience s’est toujours partagée entre l’homme et la femme –, quand la femme est dans l’attente d’une stabilisation, d’une vie de couple, d’une famille, d’une maison, etc., l’humour peut être quelque chose de déstabilisant et peut envoyer des signaux contradictoires. Ce n’est pas tout le temps l’humoriste qui gagne. Il peut gagner, un peu plus tard, quand la femme est dans sa vie, qu’elle a fait sa vie. Mais quand elles sont jeunes, elles aiment l’humour, mais assez rapidement, l’humour peut devenir problématique aussi au sein du couple. Ce qui est une qualité va vite devenir un défaut, parce que chez moi, c’est une philosophie, donc l’humour ne va pas disparaître une fois qu’on sera en couple. Et au bout d’un moment : Mais tu peux être sérieux, mais quand même… Je préfère être dans l’humour que dans la violence, mais l’humour peut parfois créer des insatisfactions chez l’autre<
V.C. : Sans faire d’analyse sauvage, on pourrait dire que chez vous, l’humour est ce qu’on appelle un signifiant maître. (Oui !) C’est quelque chose qui vous signe.
M.B. : C’est ma philosophie de vie, oui !
V.C. : Et puisque humour et humeur, c’est le même mot, jusqu’à la fin du XVIIème, je crois encore, et que c’est en anglais qu’il y a eu ce glissement, comme le mot fleureter qui a traversé la Manche pour nous revenir avec l’écriture flirter. J’aime beaucoup, moi, ces glissements.
M.B. : Et ce que vous êtes en train de me dire sur les jeux du langage, ça me fait inventer cette phrase pour vous, maintenant : Mais l’humour peut mener l’amour à l’humus.
V.C. : Mais complètement ! Rien de plus humain puisque humain vient de humus.
M.B. : Moi, je pensais à l’amour qui meurt. L’amour peut faire mourir (Le lapsus est entendu) l’humour peut faire mourir l’amour !
V.C. : Et ça, dit par un juge, quand on voit le nombre de féminicides…
M.B. : Ce n’est pas de l’amour, ça !
V.C. : Une petite question alors : ce n’est pas de l’amour, alors c’est quoi ?
M.B. : C’est une immaturité affective. Ce sont des gens qui ont une immaturité affective, qui fixent sur un objet, qui n’arrivent pas à prendre en considération l’objet comme une personne, et donc l’objet est un objet possédé. C’est la dépossession de l’objet qui mène à sa perte. Comme l’enfant, qui, de rage, va déchirer ou casser un jouet de son petit frère auquel il n’a pas le droit d’avoir accès. Pour moi, ce n’est pas l’amour. Et je pense qu’il est grand temps d’abandonner cette notion de crime passionnel. Encore que ça reste une passion, mais une passion négative, mais ce n’est pas de l’amour.
V.C. : Est-ce qu’il y a des passions positives ?
M.B. : La sieste ! (rires) J’avoue que la sieste, le vin, le sexe… Bien sûr qu’il y a des passions positives, la lecture, et j’en passe…
V.C. : Lacan a parlé de l’amour, la haine et l’ignorance, les trois passions de l’être.
M.B. : L’ignorance n’est pas une passion.
V.C. : Ah si ! On pourrait dire que la plupart des gens ne veulent rien savoir de…
M.B. : Oui, mais l’ignorance n’est pas une passion. L’ignorance ne se revendique pas.
V.C. : Ah si ! Je ne veux rien en savoir ! Par exemple dans le Je m’en fous, ou dans la réponse au Pourquoi tu fais ça ? : Ta gueule ! C’est la pire…
M.B. : Non, je crois que le pire, ce n’est pas le sot ignorant, comme chez Molière dans Les Précieuses ridicules, mais c’est le sot savant. Il est beaucoup plus dangereux. C’est Trump.
V.C. : Mais le psychanalyste doit être ignorant. Il doit avoir une passion pour l’ignorance, qui le pousse à ne jamais savoir à la place de l’autre ce qu’il va venir vous dire, sinon…
M.B. : Mais je ne régis pas ma vie, ni personnelle ni professionnelle, comme un véritable psychanalyste. L’ignorance n’est pas pour moi un …
V.C. : Mais ça vous intéresse, la psychanalyse !
M.B. : Oui, bien sûr !
V.C. : Vous avez accepté cet entretien…
M.B. : Je ne savais pas que vous faisiez de la psychanalyse, je croyais que vous faisiez des pâtes.
V.C. : Des quoi ? Des passes ?
M.B. : Des pâtes ! (rires) Alors là, il est chez vous le lapsus !
V.C. : Un lapsus ? Un Witz ! Vous croyez que je vais vous nourrir ? Quand on voit le divan, on voit que tout est fait, dans le cabinet, tout est fait en direction de ce que Lacan a appelé la passe. Vous allez raconter, à la fin de votre analyse, à quelqu’un qui n’est pas encore arrivé tout au bout, ce avec quoi vous vous êtes bataillé pendant des années. (Oui !) Savez-vous qu’avec mes enfants je dois parler de Raël, pas de Lacan ?
M.B. : De Raël, pourquoi ?
V.C. : Parce que quand je parle de Lacan avec mon compagnon, qui m’a au fond appris à lire Lacan, ce nom leur devient insupportable, comme quelqu’un qui parlerait toujours du même personnage.
M.B. : Ah oui ! Non, mais moi je vous connais, et d’autre part, les discussions qu’on a eues ont toujours été fondées sur le [questionnement du] langage. Je sais que vous êtes quelqu’un de très cultivé, vous êtes intelligente. (Ouh la la ! Ça, je vais devoir couper !) Vous avez une intelligence intellectuelle, ce sont pour moi des valeurs que je partage. Et du coup, ça m’intéresse de voir des gens qui ont lu. Lacan, je le connais assez peu. J’ai une image très Disneyland de Lacan, très schématique, comme de Freud, avec sa relation au mot d’esprit et sa relation à l’inconscient. J’ai l’impression que ce sont des gens qui jouent sur des interprétations psychanalytiques avec le langage. Cela, ça m’intéresse beaucoup, et je suis tout à fait conscient que les lapsus, la facilité et la propension à faire du calembour, instinctivement, sont aussi des manifestations d’un état psychique. Je sais que j’ai un peu cette problématique-là, elle est présente chez moi, elle est présente chez un Rausis7, chez des gens comme ça. Ça sort tout seul, et ça fait rire les autres.
V.C. : Mais des gens comme ça, c’est joli comme vous le dites, parce que vous donnez une sorte de lettre de noblesse à quelque chose qui pourrait être insupportable à d’autres. (Tout à fait) Il y a quelque chose d’une légèreté.
M.B. : Une élégance, cette volubilité, chez Rausis, comme chez moi. J’ai des côtés auto-centrés, mais j’aime quand même bien l’échange. J’aime beaucoup l’échange avec les gens. Beaucoup de personnes m’ont dit : Mais tu n’écoutes pas. En fait, ce n’est pas que je n’écoute pas, mais ma façon d’écouter, et aussi, quand j’instaure la parole avec l’autre, j’écoute en parlant. Des mois après, je peux restituer la conversation beaucoup plus que les personnes qui m’avaient reproché de ne pas écouter. Mais ça, c’est un processus. Il faut le connaître.
V.C. : Vous avez cette tournure d’esprit qui est quand même un peu surprenante, qui doit étonner autour de vous.
M.B. : Alors ceux qui me connaissent bien, non ! Et ceux que je ne connais pas tellement, j’aime bien les déstabiliser, au début par l’humour, pour voir un peu comment ils se situent par rapport à l’autre, jusqu’où on peut aller avec eux. Et je sais que ceux avec qui ça matche tout de suite vont devenir des amis, que je pourrai faire des choses avec eux dans la vie. Et moi j’ai besoin, alors je ne sais pas d’où ça vient, j’ai besoin d’être totalement à l’aise avec l’interlocuteur dans ma vie privée. Si je sens que je n’ose pas faire des blagues, c’est qu’il y a un problème. Et souvent, le problème ne vient pas tellement de moi. Alors que ça pourrait donner l’impression d’être un problème d’émission, c’est un problème de réception. Alors j’anticipe, et je vois que la réception ne sera pas bonne, donc je fais attention à ce que je dis. Et si je fais attention à ce que je dis, je ne serai jamais dans la relation.
V.C. : Ah oui ?
M.B. : Si je fais attention à ce que je dis avec les femmes, je ne serai jamais dans la relation. Si je fais attention à ce que je dis avec certains interlocuteurs, c’est qu’il n’y aura jamais de lien d’amitié, il n’y aura jamais un lien d’amour. J’ai besoin de ne pas faire attention à ce que je dis.
V.C. : Une phrase que j’ai beaucoup dite, et qui m’interroge sur moi, c’est que je perdrais un ami pour un bon mot. J’ai dit des mots qui me sont revenus, et que j’attribuais à d’autres. Ainsi ce mot sur un chanteur, dont je disais qu’il était le seul qui ne disait jamais de mal des autres chanteurs, parce qu’il ne parlait que de lui. Le mot est un peu méchant quand même.
M.B. : Oui, parce que ça fait allusion à son égocentrisme. Un égocentrique, souvent, n’a pas tellement de recul sur lui-même.
V.C. : Vous connaissez cette définition de l’égoïsme : c’est quelqu’un qui ne pense pas à moi.
M.B. : Exactement ! Mais il y a l’égoïsme, et l’égocentrisme. Ce sont deux choses totalement différentes. L’égoïste, pour moi, c’est celui qui va ne pas vouloir payer le repas aux autres, qui va toujours jouer sa carte avant les autres. L’égocentrique, franchement, on ne peut pas être un artiste si on n’est pas égocentrique ! L’artiste non égocentrique, j’aimerais voir sa production ! (rire) Parce qu’on est obligé de passer par la réalité du monde qui nous entoure à travers notre propre prisme, comme n’importe quel artiste, pour pouvoir la restituer avec le décalage artistique, ou le décalage humoristique. J’aime bien cette notion de décalage, que je reprends chez Koestler, dans Le Cri d’Archimède. Il y explique bien le rôle du sage, du bouffon et de l’artiste. Le sage doit restituer la réalité du monde de la manière la plus objective possible, ça pourrait être le rôle du juge. Le bouffon, au contraire, doit procéder du décalage pour montrer le côté humoristique, le côté drôle du monde, que les autres n’ont pas su saisir. Donc on est obligé de passer par la phase d’égocentrisme, sinon ce n’est pas possible.
V.C. : C’est pour ça que le XVIIème siècle vous intéresse, parce que c’était possible ?
M.B. : Non ! Le XVIIème siècle m’intéresse parce que c’est le siècle des moralistes. Les moralistes, pour vous qui êtes tellement attentive aux mots, ça m’énerve quand on les confond avec les moralisateurs. Quand on parle des gens moralistes, je réagis chaque fois, ils veulent dire les moralisateurs. Un moraliste – il y en a eu beaucoup dans l’histoire des idées, de la culture –, les moralistes sont des gens, je parle des moralistes littéraires, qui observaient les mœurs de leur société. La Rochefoucauld, La Bruyère, la Fontaine, Molière, Boileau, ça, ce sont les grands. L’une des premières caractéristiques est de restituer dans la langue la réalité du monde, c’est-à-dire les mœurs de l’époque, mais avec un affranchissement total de la forme.
Ainsi La Fontaine avec le poème, Molière (Il sort de sa poche Les Précieuses ridicules) que vous pouvez lire de deux manières, soit comme au théâtre, soit comme l’œuvre d’un moraliste. On peut en tirer une phrase (Il ouvre au hasard et lit) : « Savez-vous Mesdames, que vous voyez dans le vicomte l’un des hommes les plus vaillants du siècle, c’est un brave à trois poils. » (rire)
V.C. : Comme la Bible ! J’adore !
M.B. : C’est magnifique ! Et il y a le franchissement de la forme. Elle n’est pas codifiée. Mais l’aphorisme est au centre du système de pensée du moraliste. Plus c’est bref, plus c’est fulgurant ! C’est ce que j’aime.
V.C. : On organise une journée le 31 mai dont l’affiche est une des douze œuvres d’un livre8 qui met en scène deux animaux qui ne peuvent pas s’entendre, représentant ainsi l’impossible conversation, chaque gravure étant accompagnée d’un haïku.
M.B. : Les haïkus, c’est la même chose. Et d’ailleurs, comme mes trois premiers bouquins9qui étaient des listes de répertoire chinoises en fait, j’avais cherché chez Li Yi-chan, qui faisait des listes. Sa première liste, c’était Ce qui sûrement ne revient pas, et le premier exemple de cette liste était : Chien qu’on appelle bâton en main.
V.B. : C’est beau !
M.B. : C’est sûr qu’il ne va pas revenir, le chien… (rire) Et souvent, il y a de l’humour. Chez La Rochefoucauld, c’est plein d’humour, comme dans les moralistes en général, Vauvenargues notamment, et surtout Chamfort. Lui c’est un désespéré. Il a essayé de se suicider par deux fois, et est mort des conséquences de cet acte, agonisant pendant plusieurs jours. Lui, c’était un mec assez drôle. Et puis, si on continue le fil des aphoristes, on les perd un peu au XIXème, que je croyais dans un premier temps être le grand siècle, mais j’en suis bien revenu. Et puis on les retrouve un peu au XXème siècle, dans les journaux. Je pense que Jules Renard est un moraliste. Cioran est un moraliste.
V.C. : Sacha Guitry aussi ?
M.B. : Sacha Guitry est évidemment un moraliste. Woody Allen est un moraliste. Woody Allen, c’est une œuvre écrite. Filmée, mais écrite. Donc vous pouvez aller picorer – j’adore l’idée de pouvoir picorer une œuvre, de l’ouvrir, de la refermer, et d’en collectionner les mots comme le faisait Pagnol, petit, quand il avait la passion pour les mots. On peut avoir la passion des citations, des aphorismes, et ça m’amène jusqu’à Quignard, qui est l’un des derniers grands moralistes.
Violaine Clément : On va s’arrêter sur ce mot, passion. Dans l’aphorisme, il y a un côté d’énigme, de mystère…
Marc Boivin : Non, on sait. Chez Molière, je l’ai un peu trop sortie du contexte. L’homme à trois poils, il y a une signification, qui renvoie à l’époque10…
Notes:
- Faim de Siecle: Marc Boivin ↑
- Slogan connu de notre conseiller fédéral, qui a fait rire toute la Suisse. ↑
- The CO2 Night Show. ↑
- Marc Boivin, humoriste et président du Tribunal cantonal de Fribourg: «Le prétoire est un théâtre de vie» ↑
- On entend aussi la question de Jacques-Alain Miller à Lacan, dans Télévision : l’inconscient, drôle de mot ! ↑
- L’insulte comme réponse du réel – Philippe Lacadée. ↑
- Humoriste aux Dicodeurs, collègue de Marc Boivin. ↑
- Instagram.com/traitnoir. ↑
- Faim de Siecle. ↑
- Puisque nous sommes à l’époque de google, j’ai trouvé en un clic. ↑