Boucler les significations
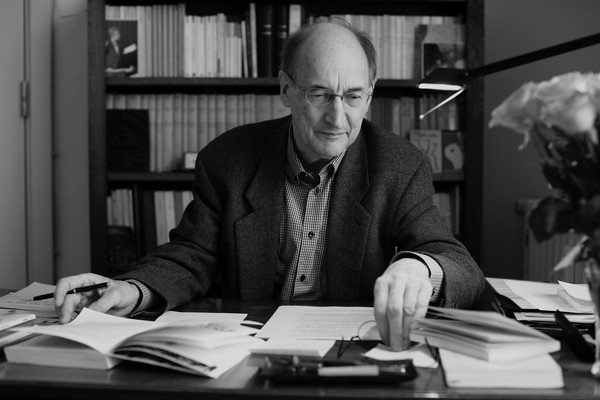
Conversation du 28 novembre avec Pierre Malengreau, psychanalyste, AME de l’École de la cause freudienne
… à partir de son livre Hélion, Ponge, Lacan, La métaphore transpercée, Bruxelles, La Lettre volée, collection « Palimpsestes », 2024.
Violaine Clément : Merci beaucoup, cher Pierre Malengreau, d’avoir accepté cette conversation pour notre blog. Vous m’avez poussée à lire Ponge1, et maintenant, vous m’engagez à aller regarder les œuvres de ce personnage singulier, Hélion. Nous avons vu à Paris l’exposition des Surréalistes à Beaubourg. Mais qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Hélion ?
Pierre Malengreau : Je suis tombé sur Hélion … Comme j’avais fini la rédaction de mon livre L’interprétation à l’œuvre, je ne savais plus très bien par quel bout prendre les choses qui m’intéressent. J’ai repris alors les textes de Ponge sur l’art, et je me suis rendu compte qu’il y avait un autre artiste, auquel Ponge avait consacré au moins trois textes. Je me suis dit que c’était énorme. Alors je me suis demandé qui était ce peintre. J’ai lu et relu le premier texte de Ponge sur Hélion et je l’ai trouvé étrange. Ponge commence par présenter un artiste en utilisant des termes peu flatteurs – cette peinture ne présente pas « le moindre charme, la moindre trace de goût » – , et il finit en étant très élogieux. C’était un texte prenant. Au fond, ce fut une affaire de rencontre, comme pour le reste, comme pour d’autres auteurs : c’est dans la rencontre que ça se joue. Voilà : je cherchais un texte, je suis tombé là-dessus, et j’y suis allé. Après, ce qui est très étrange, c’est maintenant, une fois que tout est fini, que je me dis : mais qu’est-ce qui m’a pris (rires) ? Je ne vais pas vous raconter mes affaires privées, mais ce que j’ai rencontré dans les textes de Ponge sur Hélion m’a renvoyé à mes propres préoccupations. J’ai travaillé longuement les textes de Ponge et les écrits d’Hélion, sans me rendre compte de cela, et c’est seulement après coup que je me suis rendu compte de tel ou tel point précis qui me concernait personnellement. En gros, ça concerne mon rapport au savoir, et une sorte de réticence ou de sensibilité que j’ai à l’égard de la langue de bois.
V.C. : À la langue de bois (rire) ?
P.M. : C’est quelque chose qui m’est à l’occasion douloureux. Les préoccupations de Ponge et les préoccupations d’Hélion sont en quelque sorte quelque chose qui touche à ça. Ils essaient, chacun à sa façon, de s’extraire des sillons dans lesquels chacun est pris.
V.C. : Les sillons, c’est une traduction du délire (« Oui, tout à fait, on peut dire ça ! »). Le sillon, c’est la lire, et en sortir, c’est le délire. J’ai trouvé formidable ce que vous dites au début, que ces œuvres n’ont pas de charme. Et cela m’a fait penser à un texte de Miller qui disait qu’il vaudrait mieux que les analystes n’aient pas de charme, qu’ils ne soient pas beaux. Votre invitation à aller regarder ces œuvres en disant qu’elles n’ont pas de charme, je trouve ça très intéressant.
P.M. : Je n’ai pas osé le dire à la femme d’Hélion, Jacqueline, que j‘ai rencontrée à Paris quand je terminais mon travail. Je n’ai pas osé l’interroger sur ce point. Je n’ai pas osé lui demander pourquoi Ponge commence comme ça, pourquoi il met cela en avant. En fait, c’est une peinture très interpellante. Elle n’est pas belle. Au départ, on a l’impression qu’elle n’est pas très intéressante, et puis elle m’est devenue très intéressante quand je me suis rendu compte grâce à Ponge, des enjeux de cette peinture.
V.C. : C’est ça : Ponge nous fait regarde Hélion autrement, comme vous m’avez fait lire Ponge. Il faut quelqu’un pour accrocher.
P.M. : Exactement ! Je n’aurais pas eu Ponge, je crois que je n’aurais pas été accroché. C’est grâce à Ponge que je suis entré dans cette peinture. J’ai beaucoup lu, j’ai beaucoup vu, mais c’est le fil que soutient Ponge qui m’a permis d’y entrer.
V.C. : C’est vrai que souvent, quand on regarde une œuvre dans un musée, on peut être tenté de lire le petit carton, pour ne pas être trop perdu. Mais là, ce n’est pas ce que vous faites. Vous signalez bien que Ponge ne décrit pas, mais qu’il écrit. C’est très différent.
P.M. : Oui, cette distinction est assez classique, même dans notre milieu. Comme l’a fait remarquer Jacques-Alain Miller, il faut distinguer deux types d’écriture. Dans un cas, le mot écriture est pris dans le sens de transcription. C’est ce qui prévaut par exemple quand Miller transcrit les séminaires de Lacan. Mais rendre présente dans l’écriture une œuvre d’art, c’est tout autre chose. Dans ce cas le mot écriture ne vise pas à transcrire ce qui est dit ou ce qui est vu. Ponge arrive – c’est magnifique, ça, pour moi – à rendre présente dans l’écriture l’absence qui est au cœur de la peinture d’Hélion. C’est cela qui m’intéresse. Il arrive à rendre compte de l’indicible qu’Hélion met au centre de sa peinture.
V.C. : Cet indicible au centre de la peinture, c’est ça que vous appelleriez le trou dans la métaphore ?
P.M. : … Non ! Enfin, ça me dérangerait de dire les choses comme ça, parce que ça localise trop l’indicible, ça le substancialise un peu trop. Le trou dans la métaphore relève de l’indécidable ou encore, pour utiliser un mot de Ponge, de l’inachèvement perpétuel. C’est un indicible en acte. On n’arrête pas de rendre présent cet indicible du fait d’essayer de le dire. C’est ça, l’opération de Ponge, c’est l’opération qu’il fait par rapport à Hélion.
V.C. : C’est une opération, pas du tout l’opération analytique, mais dont vous vous servez, ou plutôt dont vous vous faites serf de ce que Ponge fait avec Hélion pour faire, comme toujours dans votre œuvre, un cours pour analystes. L’analyste peut se servir de ça.
P.M. : Oui, tout à fait. C’est pour cela que ça m’intéresse. Parce que dans ma pratique, je suis confronté quand même, comme chacun d’entre nous, à cette sorte d’envahissement de l’histoire et du sens. Et il est très difficile d’arriver à introduire cette dimension de l’indicible. Il faut sans cesse y revenir car tout nous pousse à vouloir la méconnaître, à vouloir la combler avec les armes du sens. Ponge m’aide à cela. Il m’aide à être attentif, dans ce que les analysants me disent, à cette dimension d’impossible à dire. À être attentif à cela dans la langue elle-même.
V.C. : Paradoxalement, c’est par la lecture que vous faites du texte d’un analysant que vous arrivez à introduire quelque chose d’autre par l’interprétation. Par exemple dans ce texte paru dans un numéro de La Cause du Désir2, lorsque vous reprenez le « merci » de cette patiente en le répétant avec une autre intonation… Je trouve curieux qu’il faille en passer par la lecture pour transmettre quelque chose de ça.
P.M. : Oui, déjà ici, au niveau de l’écrit, ça se joue entre un point d’exclamation et un point d’interrogation. On ne pourrait pas faire jouer l’équivoque si on ne pouvait pas passer par l’écriture, grammaticale ici.
V.C. : Celui qui ne saurait pas lire ne pourrait pas faire cette opération. Ou bien il pourrait le faire, mais ne pourrait rien en dire…
P.M. : Oui, il faudra ajouter que nous sommes tous de très mauvais lecteurs.
V.C. : Ah oui ?
P.M. : Eh oui ! Pour moi en tout cas, je trouve très difficile de lire ce que les analysants racontent. Parce que nous sommes tout le temps happés, pris par le sens, pris par le contenu de ce qu’ils disent. Je trouve cela très difficile. Lire ce qui se dit suppose une ascèse en permanence. Ce n’est pas une fois pour toutes. Cela m’a frappé lors des dernières journées de l’Ecole. Le thème des Phrases marquantes est un thème formidable. Mais ce qui m’a frappé, c’est la difficulté que nous avons à lire les phrases marquantes, à les prendre par le bout de la lettre. Très vite, nous tentons de les déchiffrer, très vite nous les prenons par le bout du sens.
V.C. : On blablate…
P.M. : Oui ! Si on veut.
V.C. : Ce que vous appelez lire, vous, c’est garder la dimension d’énigme, et d’« illecture ».
P.M. : Tout à fait. C’est même une indication précise que Lacan formule dans le séminaire Encore, je dirais p. 45. Faut-il interpréter les phrases marquantes ou au contraire chercher à tarir l’appel de sens qu’elles alimentent ? Lacan répond clairement : la première chose à faire est de partir de ceci que nous sommes là face à un dire et qu’il s’agit de lire les effets de ce dire. Il s’agit de lire cet autre effet du langage qui est l’écrit. Lire ce qui s’écrit. Il y a une indication précise. Je pense qu’on n’a jamais fini d’apprendre à faire cela.
V.C. : On pourrait dire : encore heureux !
P.M. : (rire) Oui, bien sûr ! Sinon, je m’ennuierais…
V.C. : Pouvez-vous imaginer qu’un jour vous aurez fini d’apprendre à lire ?
P.M. : Non ! Non (rires)…
V.C. : C’est vrai que j’ai un petit-fils dont le sens de l’humour me fait penser au vôtre. Son jeu consiste, lorsque sa mère lui demande d’écrire son prénom … ce qu’il sait très bien faire –, à l’écrire à l’envers. Sa mère panique un peu, se dit que son fils ne sait pas lire. Par chance, il a rencontré chez son enseignant quelqu’un avec qui il peut jouer de ça. Le mot humour est récent : il se disait avant le XVIIIe siècle : humeur (« Ah oui ! »). C’est amusant, car Lacan disait qu’il n’avait pas souvent l’occasion de rire, qu’il n’avait pas beaucoup de gens avec qui rire. Pourrait-on dire que vous faites partie de ceux avec qui on a envie de rire ? Vous avez toujours, dans votre sérieux, ce petit décalage…
P.M. : Le rire dans la cure, c’est quelque chose qui mérite notre attention. Qu’est-ce que nous faisons par exemple quand une équivoque a pour effet de déclencher le rire d’un analysant ? Si je reviens sur l’exemple de ma pratique que vous rapportez, fallait-il que je me mette à rire avec cette analysante ? Je pense que si l’analyste rit, il faut qu’il sache ce qu’il fait. Je pense qu’il vaut mieux qu’il retienne son propre rire. Ou s’il rit, ça ne peut être qu’un temps, pour après ne plus rire, pour que l’analysant perçoive bien qu’il y a un moment où l’analyste n’est plus complice de cette sorte de poussée de jouissance que le rire véhicule.
V.C. : Rire avec l’autre, ce n’est pas toujours indiqué.
P.M. : Non…
V.C. : Je reviens à cette question qui vous a un peu surpris, à propos de ce passage de Lacan que j’aime beaucoup, où il dit que dans un couple, on peut s’entendre… crier. Crier, ce n’est pas rire, ce n’est pas non plus lire, mais vous trouviez que ça n’avait pas grand-chose à voir avec votre texte. Et pourtant : Ponge essaie d’attraper quelque chose chez Hélion, et vous, vous essayez de nous en transmettre quelque chose. Autre chose. Je suis toujours surprise qu’on puisse transmettre quelque chose.
P.M. : Oui, c’est cela mon souci lorsque j’écris. J’ai, certes, un style qui est le mien, et il m’arrive de rêver qu’il pourrait être plus aéré, plus facile à lire, moins dense. Mais je ne sais pas faire autrement. C’est comme ça. Par contre, il m’importe que mes textes sur Ponge puissent aussi toucher un public qui ne soit pas analytique. Quand mes deux livres sur Ponge et Lacan sont lus par des philosophes, ou par des artistes, cela me satisfait. Au fond, je suis content. Par exemple, mon livre « L’interprétation à l’œuvre. Lire Lacan avec Ponge » a été lu et discuté à la Société de Lecture de Francis Ponge, à la SLFP. Pour moi, c’est une grande satisfaction : ils l’ont lu, ils l’ont apprécié, et nous avons pu en discuter. Quant à mon livre sur Hélion, il a été apprécié par les gens qui ont organisé l’exposition au Musée d’art moderne de Paris. Que des gens qui ne sont pas du tout du milieu analytique et qui ne connaissent pas notre vocabulaire puissent entrer dans le livre, c’est ce que j’aime, c’est cela que je vise. Je ne vise pas seulement des analystes, mais aussi des non-analystes.
V.C. : Lacan visait aussi un public hors analystes. Il le dit du reste dans le « Discours de Tokyo », ironisant sur les psychologues et psychiatres qui ne savent rien. Vous vous adressez aussi aux philologues. Qu’est-ce qui a fait votre parcours, qu’est-ce qui vous a amené là ? Vous n’êtes pas devenu psychanalyste parce que vous rêviez de l’être depuis vos cinq ans ?
P.M. : Eh bien oui, à mon avis… (rire). Qu’est-ce qu’il y a à expliquer ? En tout cas ce qui s’est joué pour moi par rapport à Ponge, c’est véritablement la rencontre avec son texte. J’avais par hasard lu le texte d’Éric Laurent citant la réson chez Ponge. Il le citait mine de rien il y a très longtemps, et c’était resté dans un coin de ma tête. Et puis, un jour, j’ai été amené à écrire un texte sur l’impact des mots et l’effet qu’ils nous font. Je sus tombé comme par hasard sur un texte de Ponge consacré au peintre Georges Braque. Cela m’a parlé. Je ne peux pas le dire autrement, c’est vraiment de l’ordre d’une rencontre. Les philologues justement, dans les discussions que j’ai eues avec eux, m’ont posé un jour la question : mais ce que vous dites sur les textes de Ponge sur l’art, est-ce qu’on pourrait le dire également pour d’autres textes de Ponge ? Pourrait-on le dire aussi à propos de ses poèmes ? Je leur ai dit que je ne savais pas répondre à cette question. Je suis plutôt parti de ma rencontre avec un texte de Ponge dans lequel il évoque le sanglot qui l’a saisi devant une peinture de Braque. Ce sanglot a eu des échos chez moi, ce dont je me suis rendu compte une dizaine d’années plus tard. C’est extraordinaire, ça ! (Oui !) Cela date d’il y a deux ou trois ans. Je me demandais « pourquoi Ponge, pourquoi ce texte ? », et je me suis rendu compte que c’était là le point, enfin l’un des points qui m’avait accroché. C’est donc absolument une question de rencontre. À un moment donné, j’ai rencontré un signifiant qui était aussi le mien, sans que je m’en rende compte. Je me suis laissé embarquer par cela, et voilà ! Je suis là où j’en suis maintenant…
V.C. : Vous n’avez pu rencontrer ce sanglot que parce que vous l’aviez déjà rencontré. C’était une re-rencontre.
P.M. : Oui ! Moi, je le savais déjà avant, mais c’était comme si je ne le savais pas. Je ne me rendais pas compte que le texte de Ponge m’avait touché à ce point.
V.C. : La rencontre, et le se rendre compte, c’est deux temps différents.
P.M. : Absolument !
V.C. : C’est là que c’est merveilleux : ces choses que l’on entend bien longtemps après. Il n’empêche que ces choses sont actives, et qu’on n’en est pas débarrassé, encore une fois, heureusement, après une analyse… on reste vivant !
P.M. : Oui, tout à fait.
V.C. : Quand on parle en analyse de la jouissance, cela m’a dès le début agacée, de n’entendre parler que de la jouissance qu’il ne fallait pas. Il faut jouir de son corps, sinon, comment faire pour vivre ? Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui, du vivant, était de trop, ce qui poussait au pire. Ce que vous arrivez à faire, c’est à écarter ce qui empêcherait de bien lire. Pour bien lire, il faut trier, on ne peut pas tout lire, il ne faut pas tout mettre au même plan, il faut élire. Vous avez élu un texte.
Parler et écrire (ek-rire), ce n’est pas la même chose. Un texte écrit qui vous parle, ça me surprend. J’ai lu que Ponge, par deux fois, n’avait pas pipé mot lors de deux examens qu’il passait à l’oral. Comment comprenez-vous ça ?
P.M. : Comment je le comprends ? Peu importe comment je le comprends. Voyons plutôt ce que Ponge en dit. Ponge revient dans un entretien sur des deux épisodes de sa vie. Il n’est pas arrivé à ouvrir la bouche une première fois lors d’une épreuve orale en philosophie, et une deuxième fois lors de son admission à l’Ecole Normale Sup. Certains commentateurs parlent d’aphasie. Ce n’est pas un mot de Ponge. Il parle de mutisme. Il repère que son parcours commence là. Et très vite, il se rend compte que ce mutisme reflète la position qu’il a à l’endroit de la langue imposée, des ronrons poétiques… et de la langue de bois. Ce dernier mot m’appartient. Ponge se sent étouffé par les paroles convenues. « Les paroles sont toutes faites et s’expriment, écrit-il, elles ne m’expriment point. Là encore j’étouffe. » Et donc, devant un professeur ou un maître, il ne veut pas se laisser aller à exprimer des paroles qui ne seraient pas lui.
V.C. : Pour pouvoir s’exprimer par des paroles, il faut qu’il les trouve.
P.M. : Clairement la poésie pour lui, c’est parler contre les paroles. Ponge essaye de sortir par l’écriture, de l’asphyxie qu’il ressent dans les paroles toutes faites. C’est une constante chez lui. Ponge est allergique aux ronrons poétiques. Il est allergique aux paroles convenues qui l’empêchent de revenir aux choses.
V.C. : Il coupe le ronron par le trait de l’écriture.
P.M. : Exactement. C’est par l’écriture qu’il traite cela. L’écriture lui permet de revenir à la racine des mots. Le mot racine est à prendre matériellement. Ses textes opèrent comme le soc d’une charrue lorsqu’elle retourne la terre pour la première fois. Ce qui apparaît ce sont des vers de terre, des rhizomes, des cailloux. Ponge mobilise par l’écriture la terre des mots.
V.C : C’est magnifique, cette expression de retourner la terre des mots ! Lacan se disait : pas poète assez… Diriez-vous que vous êtes devenu poète avec Ponge, ou l’étiez-vous déjà ?
P.M. : (rire) Oh, je ne suis pas poète assez non plus. Il y a deux choses. Il y a d’abord ce que dit Lacan à son propos : « je ne suis pas poâte assez ». Il ne dit pas poète, mais poâte, pour faire passer dans la langue une notion autre que simplement significative. Et dans le même passage, il se demande ensuite pourquoi les analysants ne seraient pas un peu plus poètes, pourquoi ils ne s’apparenteraient pas un peu poète. Le « pas poâte assez » vaut donc aussi pour les analysants.
V.C. : Les analysants aussi !
P.M. : Oui. Personnellement je n’ai pas de goût particulier pour les poèmes et la poésie. Et si Ponge m’intéresse tellement, c’est pour ses textes sur l’art et pour la façon dont il en fait une sorte de poésie en prose.
V.C. : Et il rase le sens, il ne le laisse pas fleurir. Quand vous parlez des racines, quand il fouaille, quand il pénètre le sol, il ne s’intéresse pas forcément à la jolie fleur qui va pousser.
P.M. : Il est même contre ça ! Il le dit explicitement. Il faut surtout se méfier des expressions trop bien dites, ou trop belles.
V.C. : C’est ça ! Et on retrouve cette histoire de votre dire du début à propos de la beauté, Il faut se méfier de la beauté (oui !) qui serait un dernier voile devant… l’horreur. On pourrait s’arrêter là ?
P.M. : On peut toujours s’arrêter quand on veut.
On arrête l’enregistrement, mais la conversation se poursuit, et donc reprend un peu plus tard…
P.M : Au fond, Ponge aimait les malentendus, et c’est lisible dans un échange épistolaire qu’il a avec Lacan. C’est paru dans un numéro de La Cause du Désir[3]. Il faut lire attentivement la réponse de Ponge. C’est la réponse d’un poète. Elle est pleine de malentendus. Ponge aimait les malentendus. Et au fond pour lui, le travail du poète est de ramener la langue dans le monde des malentendus et des expressions maladroites. L’écriture d’un poème s’inscrit dans une boucle. Il faut « franchir la dogmatisation, boucler les significations : révéler, élaborer, raffiner, abolir »[4]. C’est bien dit. C’est magnifique. Ponge décrit comme ça un parcours qui peut aussi nous servir.
V.C. : Ce que Ponge fait pourrait-il être exemplaire d’un chemin analytique ? La liste des signifiants que vous avez énumérée jusqu’à : on abolit, résonne comme un parcours.
P.M. : Oui, tout à fait, même si je pense qu’il ne faut pas faire ce rapprochement trop vite. Je préfère m’en tenir ici au niveau d’analysant que je reste toute ma vie, d’un analysant qui ne cesse pas de faire ce parcours : de rencontrer, d’élaborer, de dogmatiser quand il élabore, de raffiner, et enfin d’abolir. Et puis on recommence (rire). Ponge appelle ça « boucler les significations ».
V.C. : On a trouvé notre titre !
P.M. : Oui, boucler les significations, c’est ça le mot de Ponge. Je suis sensible à cela, parce qu’au fond, quand on lit Lacan, on remarque qu’il n’a pas arrêté de faire ce parcours. Il n’a pas arrêté d’abolir, de mettre en cause, de remettre au travail ce qu’il avait élaboré précédemment. Par exemple, j’ai été frappé récemment par une formule de Lacan que je ne sais pas comment prendre. Cela m’a tellement frappé que je ne sais plus où je l’ai lue. Je pense que c’est dans le séminaire Le Sinthome, mais je ne suis pas sûr, là où Lacan dit : « Le réel, c’est mon symptôme, le symptôme d’un tout seul. » Cette formule fait vaciller le sens du mot réel que nous mettons à toutes les sauces. Nous sommes priés de remettre ce mot au travail, nous sommes invités à refaire une boucle. C’est vraiment le cheminement que décrit Ponge. Lacan nous a appris à manier le mot de réel toute sa vie, et à la fin de sa vie, il nous envoie : « eh bien, vous savez, c’est mon symptôme à moi, ça ne vaut peut-être que pour moi »…
V.C. : Oui ! On travaille cela à Lausanne dans un groupe, Lacan et les mathématiques, aussi à Aigle avec Dominique Holvoet avec qui nous avons lu L’Étourdit. On a terminé sur la question des bouts de réel, chacun ayant affaire au sien, à son petit bout. C’est pour ça que c’est tellement compliqué de s’entendre, parce qu’on n’a pas affaire au même petit bout. Ça rend la communication un peu impossible. Mais je suis d’accord avec vous, j’emploie le mot impossible par caricature. Cherche-t-on à l’attraper, à le tresser avec celui de l’autre pour en tisser un petit texte ?
P.M. : Hmmm…
V.C. : Cette fois, on va s’arrêter, parce que sinon, on va refaire une boucle… (rire)
Video :
Photo de Pierre Malengreau par Jean-Claude Encalado.
Notes :
- « L’interprétation à l’œuvre. Lire Lacan avec Ponge », ASREEP Blog. ↑
- Pierre Malengreau, « Ce qui résiste à l’inconscient », La Cause du désir , no 80, Paris, Navarin, 2012/1, p. 46. ↑
- On trouvera les deux lettres manuscrites, l’une de Lacan, « Cher Ponge, c’est Lacan… », et la réponse de Ponge, « Cher Lacan, Votre pneu me parvient… », dans La Cause du Désir, no 106, « Créer l’élangues », p. 10-14. On trouve aussi dans ce numéro l’hommage de Pierre Malengreau : « Ce n’est pas avec des idées qu’on fait une analyse », p. 16-21. ↑
- Francis Ponge, « Pour un Malherbe », La Pléiade, Œuvres complètes, II, p.265. ↑

