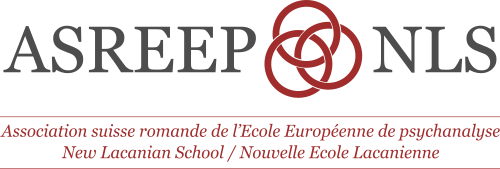Conversation avec Élisabeth Leclerc-Razavet à propos de son dernier livre : Trace de vie/écriture*
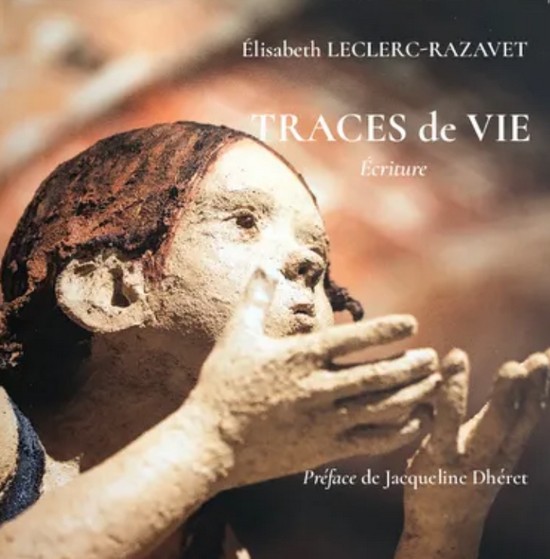
Conversation du 29 janvier avec Élisabeth Leclerc-Razavet.
Une route nouvelle
Violaine Clément : Merci beaucoup, Élisabeth, d’avoir accepté cette conversation pour notre blog. Vous connaissez déjà certains de nos membres, dont François Ansermet (bien sûr !). C’est vous qui m’aviez accueillie, lorsque vous avez invité quelques nouveaux membres de la NLS, ce que j’avais trouvé très sympathique. Une association, c’est aussi ça, être acceptée par d’autres. J’ai lu avec intérêt votre dernier livre, Traces de vie/Écriture, préfacé par Jacqueline Dhéret : « J’y vais ! Une femme se met en marche et passe à l’écriture. Ce n’était pas la première fois. »
Élisabeth Leclerc-Razavet : Non, en effet, et il me faut dire au passage que la publication de mon premier livre, L’inconscient sort de la bouche des enfants, je la dois à François Ansermet, dans la collection qu’il a dirigée aux éditions Cécile Defaut. Mais avant de parler du dernier livre que vous évoquez, j’aimerais tout d’abord volontiers revenir sur notre rencontre.
V.C. : Mais oui, allez-y !
E.L.-R. : Je voulais vous remercier pour l’intérêt que vous portez à mon livre. Comme vous le disiez, ce blog est un pari sur la rencontre. Et je me suis demandé sur quoi se fondait la nôtre. Les psychanalystes ne sont pas des êtres désincarnés. Il se trouve que vous avez remarqué cet ouvrage… parmi tant d’autres. Notre rencontre se fonde aussi sur un congrès de l’AMP à Paris, il y a environ quinze ans, ou plus, que vous venez de me rappeler. Les membres de l’ECF invitaient alors à dîner chez eux les membres venus d’ailleurs. Vous êtes venue chez nous ! Et de surcroît vous nous aviez offert les Vêpres de la Vierge, de Monteverdi, chantées par un chœur dont vous faisiez partie, je crois, tant de fois écoutées par nous depuis. Tant d’années après – nous n’avions jamais travaillé ensemble jusqu’à la dédicace de mon livre aux Journées 53…
V.C. : Si, nous avions une fois travaillé ensemble : j’étais venue en contrôle chez vous, une fois, peu après le congrès. J’ai d’ailleurs su et découvert ce jour-là, par votre interprétation, quelque chose que je n’ai compris qu’en lisant le cas Victor dont vous parlez dans votre livre.
E.L.-R. : Oh… J’avais oublié.
V.C. : En Suisse, je suis aussi responsable du seul laboratoire actif du CIEN. La rencontre avec cette École, dans laquelle on vous accueille, non pas au nom d’un savoir déjà là, mais d’un savoir à venir, ça m’a beaucoup touchée. Dans votre livre aussi, j’ai rencontré votre manière de tresser cela avec la féminité.
E.L.-R. : Vous avez parlé de la valeur de témoignage de mon livre. Vous évoquiez la racine grecque du mot « le témoin », si l’on revient à la racine latine, on trouve testimonium, et à sa valeur de déposition, signifiant qui revient dans mon livre, de transmission, qui fait écho à la trouvaille d’Hélène Guilbaud, responsable de la Bibliothèque à l’École, tirée du Séminaire de Lacan …ou pire, et qu’elle a mise au fronton des livres de Bibliotheca : « C’est peut-être autrement qu’il vous faut le lire, ce que je dis. Il faut le lire avec innocence. Remarquez que de temps en temps quelque chose peut vous toucher. » C’est mon souhait le plus vif.
V.C. : C’est plutôt rare, vous m’avez demandé de vous poser des questions. Ce n’est pas toujours le cas pour ce blog. Parmi ces questions, prenons donc la première. Vous écrivez p. 81 : « Si on ne choisit pas le moment où on vient au monde » – phrase que vous avez prononcée lors de la dernière AG de votre mandat à l’ACF Île-de-France –, que pourriez-vous dire de votre réponse : « Seule la réponse compte » ?
E.L.-R. : « Si on ne choisit pas le moment où on vient au monde » … vous me demandez ce que signifie cette phrase prononcée en 1998, à la dernière AG de mon mandat de présidente (c’était encore nommé ainsi à l’époque) ? Oui, « Seule la réponse compte », car il s’agit de l’acte. Cette phrase est reprise à deux endroits dans le livre, au chapitre général : « Transmission », mais aussi dans les sous-chapitres « Désir et politique », et « Quand sonne l’heure de la vérité ». Donc, je ponctue en 1998 le temps de ma responsabilité de présidente de l’ACF Île-de-France. C’est une fonction politique à un moment de crise institutionnelle dans l’École, une période très difficile marquée par des interrogations et de nombreux départs. En tant que présidente, ma fonction de boussole d’orientation dans le lien ACF à l’École est capitale. Enjeu de mon dire, dans mon rapport à la psychanalyse et à l’École, et là, seule ma réponse compte. Mais je m’adresse aussi aux membres, et au choix qu’ils ont à faire. Cent soixante-dix membres, je crois, à ce moment-là. Voilà ce que je dis : « Il y a le temps de la réflexion, pourquoi pas le temps de la critique, et il y a le moment de l’acte. À l’heure de l’acte, la division subjective se suspend au profit d’une coupure. Dire un oui ou dire un non se sépare d’une barre radicale. Chacun est à “ l’heure de la vérité” – dans son rapport à la psychanalyse, à Lacan, et à l’École, séparé de la position qu’il avait à l’heure de l’Autre. »
Il se trouve que s’ouvrait à ce moment-là la dimension mondiale de l’École, l’AMP, avec cette formulation : « L’AMP est entrée dans l’École ». C’est comme l’entrée dans le monde. La réponse du sujet est décisive. Elle peut se séparer très tôt de l’heur(e ?) de l’Autre.
V.C. : Magnifique texte, dont on entend à l’oral l’absence de e dans l’heure de l’Autre. On n’est jamais à l’heure de l’Autre. On parle beaucoup de la recherche du bonheur, mais c’est plutôt de la recherche de son heur si on veut éviter d’y rajouter un t, d’en faire un heurt, mais d’en être responsable. (Absolument !) Et on voit que la petite fille que vous êtes toujours est encore à l’heure. Vous êtes joyeuse. C’est très impressionnant pour moi quand on rencontre quelqu’un qui fait résonner cette réponse de Lacan à la question de Miller dans Télévision sur ce qui fait sa joie. Vous êtes vraiment dans cette question de l’acte qui suspend la division.
E.L.-R. : Oui, votre question m’a permis de le reprendre comme cela.
V.C. : En ce sens, la femme qui, politiquement, dans une période où ça ne se faisait pas beaucoup, a su donner une réponse dans la trace de ce que la petite fille a su donner comme réponse. Lacan disait qu’il avait cinq ans, Je me demandais quel âge vous diriez que vous avez ? Subjectivement ?
E.L.-R. : Ah ! Moins que ça… (rire)
V.C. : Pour moi aussi, je dirais quatre ans…
E.L.-R. : Beaucoup moins que ça, peut-être… J’ai eu d’ailleurs beaucoup de mal à trouver. Certainement moins de deux ans. Mais un interdit de savoir fonctionnait là.
V.C. : Et je me fais enseigner chaque semaine par ce petit garçon de moins de deux ans que je « baby-sitte », ou qui me « granny-site », qui utilise le langage des signes pour redemander : « Encore ! ». Je me dis qu’il a raison de ne pas lâcher le mot. Il se fait mieux entendre ainsi. Tout ça, c’est du côté de l’heur. Votre réponse à vous est donc de rester à l’heur.
E.L.-R. : Oui, et je reviens à l’AG de l’ACF Île-de-France, j’avais donc quelque chose à dire. Parce qu’il y avait un choix à faire entre quitter ou rester à l’ACF, c’est-à-dire dans le lien à l’École, à travers l’ACF. J’avais à rappeler que la division se suspend, qu’il y a un acte à poser.
V.C. : C’est ça ! On ne peut pas passer sa vie à attendre que l’acte se pose sans qu’on y soit. Vous l’avez fait, et vous le faites encore. Cela nous amène à cette deuxième question : « Comment devient-on une grande personne ? » Éric Laurent vous dit : « Vous serez la première à entrer à l’École par la passe ». Est-ce que c’est ça, devenir une grande personne ? J’aimerais vous interroger sur ce que j’appelle une grande personne de compagnie. On en trouve de moins en moins…
E.L.-R. : Je vais vous dire comment j’ai navigué dans votre question. Je l’ai d’abord scindée en deux. J’ai commencé par : « Comment devient-on une grande personne », et ensuite : « enfant de la psychanalyse » ?
Oui, comment grandir ? Question quotidienne dans notre pratique, tant avec les adultes qu’avec les enfants. Mais votre question m’a renvoyée directement à la clôture que j’ai faite à la journée de l’ACF Île-de-France, en 1997 – donc un an avant l’AG de la fin – dont le titre était : Il n’y a plus de grande personne. Cette intervention, j’avais envie d’en dire un mot parce qu’elle a été marquante pour moi, et dans mon livre, elle prend place sous le titre : Présidence, responsabilité, orientation. Lacan fait écho à cette déclaration : Il n’y a plus de grande personne (tirée du Miroir des limbes, de Malraux, phrase qui a été prononcée en 1940, dans la Résistance française), dans l’« Allocution sur les Psychoses de l’enfant ». Voilà ce qu’il dit : « Voilà qui signe – par cette déclaration – l’entrée de tout un monde dans la voie de la ségrégation ». Il craint que la conséquence en soit « le règne de l’enfant généralisé ». Donc plus de grandes personnes, que des enfants ! Or, « de cette enfance à la marque si prégnante, il s’agit bien de faire quelque chose ». C’est votre question : En faire quelque chose pour devenir une grande personne.
Les questions de la responsabilité et de la formation humaine sont posées là, et avec elles l’éthique de la psychanalyse. Et je cite là une de mes phrases marquantes, tirée de Lacan, cela va sans dire, tout le monde la connaît : « Toute formation humaine a pour essence, et non pour accident de réfréner la jouissance ». Phrase fondamentale, toujours dans cette « Allocution », en 1967, base de l’éthique de la psychanalyse et des psychanalystes. La deuxième partie de votre question porte sur ces dits d’Éric Laurent : « Enfant de la psychanalyse », et « Vous serez la première à entrer à l’École par la passe ».
Là aussi, j’ai coupé votre question, encore en deux, car ce sont deux temps différents de la cure.
« Enfant de la psychanalyse », cela m’a d’abord renvoyée à la question de l’enfant et du rapport au savoir, le savoir dont il s’agit dans la psychanalyse. L’écrivaine Catherine Benhamou le dit très joliment dans son petit livre : 5 secondes. Je ne sais pas si vous le connaissez (Non !). Je vous l’enverrai, c’est un bijou. Voilà ce qu’elle écrit : « On dit que les bébés savent tout quand ils naissent, et que Dieu leur met le doigt sur la bouche pour qu’ils ne disent rien ; on dit que c’est pour ça qu’ils ont une fossette. »
V.C. : J’avais compris que la fossette était ici, là où le doigt marque quelque chose sous le nez, comme le signale Nancy Houston dans L’empreinte de l’ange. Parce que c’est aussi comme ça qu’on dit : Chut !
E.L.-R. : J’aime votre remarque. Sur le savoir des bébés, j’ai trouvé ça absolument magnifique. Je suis aussi une mère. Dans l’après-coup, je peux dire que c’est certainement de là que vient le choix des sculptures dans mon livre. « Enfant de la psychanalyse » n’est pas, bien sûr, à prendre au sens de l’âge. C’est un signifiant employé par mon analyste. À la fin de mon livre, cela fait allusion au dit de Lacan : « Nous sommes tous fils de la parole ». Difficile dans mon cas d’employer le mot de fils. Enfant dit la filiation, la génération. C’est de l’ordre d’un don. Mais aussi, la transmission, celle de l’éthique de la psychanalyse, le prix de l’entrée dans le langage, pour le sujet, tout enfant qu’il soit.
Cela me renvoie à une boutade que je fais dans l’interview à propos des phrases marquantes : « J’ai eu Lacan dans mon biberon » (rire). Cette phrase m’a surprise moi-même, mais je peux dire qu’elle m’a aussi réjouie. Elle interprétait impromptu un savoir inconscient tapi en gésine dès cet âge-là. L’interprétation s’est faite avec l’écriture de mon livre : Trace de vie/Écriture, et son exergue : « Élaborer l’inconscient n’est rien qu’y produire ce trou. Il y a trace d’une rupture de l’être. Long trajet au-delà des jeux sériels de la parole, à circonscrire, border ce lieu où il n’y a pas de mots ». Lacan le dit bien. Là, il importe que l’analyste ait des mammes, ce qui fut le cas !
J’en viens maintenant à cette phrase d’Éric Laurent par laquelle il m’a accueillie à l’entrée d’une séance : « Vous serez la première à entrer à l’École par la passe ». N’y cherchez pas une information. C’est une parole, une interprétation, un acte.
V.C. : Formidable, encore une fois. Cet accueil par Éric Laurent peut résonner comme une désignation. Que l’analyste ait des « mammes », c’est une chose. Comment l’avez-vous entendue, cette interprétation ? Je pense à cette collègue de la NLS qui, ayant été nommée AME, avait trouvé difficile cette nomination, alors qu’on pourrait penser que ça lui a donné plus de consistance. Et pour vous, est-ce que ça a été facile à accepter ?
E.L.-R. : Oui, bien sûr ! C’est très différent. C’est une scansion formidable, une coupure au cœur même de mon trajet, et une entrée comme Membre de l’ECF par la passe.
V.C. : Ce qui est étonnant, c’est qu’il le dit en vous recevant, alors que vous n’avez encore rien dit. Parfois, c’est l’analyste qui dit ce que l’analysant a à dire.
E.L.-R. : L’acte est justement là ! C’est mon analyste qui m’annonce cette entrée à l’École par la passe. Je deviens Membre de l’École. Effet radical. Coupure qui marque un avant et un après.
Il s’agit de suivre cette « route nouvelle ». Il en savait le prix.
V.C. : C’est ça ! Et il arrive aussi qu’un analysant dise à l’analyste, à la séance qui suit : « La dernière fois, vous m’avez dit que »… alors que c’est l’analysant qui l’avait dit. On ne sait pas toujours qui dit en séance. Mais celui qui en prend la responsabilité…
E.L.-R. : Ça, c’est l’analysant.
V.C. : C’est l’analysant qui fait son analyse. Magnifique ! Donc ce livre contient vos points de capiton. J’aime bien ces livres qui se lisent comme une petite bible, sans Dieu évidemment, sinon l’inconscient (rire), et dans lequel on peut prendre ce qu’on veut, à l’endroit, à l’envers. On peut attraper quelque chose à la fin du livre, revenir à la deuxième page, le lire en plusieurs fois.
E.L.-R. : C’est tout à fait ça. Il y a plusieurs portes d’entrée, et on y voyage au gré de ses envies.
V.C. : Voilà la troisième question : « Quelle joie trouvez-vous dans ce qui fait votre travail, en tant qu’analyste femme, toujours analysante ? »
E.L.-R. : Pas facile du tout de répondre à la question de la joie. Je dois vous dire que j’ai beaucoup travaillé pour préparer cet entretien avec vous, et que certaines choses se sont formulées différemment. Toujours analysante ne veut pas dire toujours en analyse, mais toujours en position d’analysante dans la transmission, et face à ce qui s’est produit comme savoir : il y a un « trou dans le savoir », un « il n’y a pas » qui se décline de différentes façons mais qui signe une rencontre traumatique.
Ce savoir, s’il est difficile à soutenir, est aussi une force. À condition qu’il soit bordé. La joie vient-elle s’articuler là ? Quand le savoir du sujet, produit de la cure, coïncide avec le savoir sur la structure, c’est là qu’il y a de la joie.
V.C. : Là, il faut m’en dire un tout petit peu plus… Cela me semble très neuf, ce que vous dites là.
E.L.-R. : La structure, c’est qu’il n’y a pas de complétude. L’entrée dans le langage implique qu’il y a un lieu d’origine, refoulé, où il n’y a pas de mots. Le parlêtre trouve ses parades, pour ne pas craindre de tomber dans ce qui fait trou dans le savoir. Il a déjà affaire au manque !
V.C. : C’est ça : il fait tout ce qu’il peut pour ne pas tomber dans le trou.
E.L.-R. : Quand le fantasme ne fait plus écran, c’est la rencontre avec le réel.Ce n’est pas sans gravité, c’est un troumatisme, une rupture qui touche à l’être, à prendre toujours au sérieux. Il importe de le border. C’est tout le travail d’une analyse. Selon chaque analysant, c’est différent. J’irais jusqu’à dire que la joie – c’est la première fois que je le formule ainsi –, c’est quand le singulier coïncide avec l’universel. Délicat d’oser ce mot. Il change selon l’époque. Vous voyez ?
V.C. : C’est ça la grosse difficulté et la singularité de l’analyse.
E.L.-R. : Absolument ! J’aime bien, ça, vous voyez, c’est un petit gain de savoir de notre rencontre.
V.C. : C’est le contraire des particularités qui feraient des catégories. Donc quand vous utilisez le mot de structure, c’est vraiment l’idée de la construction. C’est l’idée du trou.
E.L.-R. : Oui, on peut le dire comme ça. De ce trou, Lacan en a fait une écriture, et seulement une écriture, S(Ⱥ ) !
Et je reviens à la joie. La joie, ne serait-ce pas aussi l’effet de la fonction de l’écriture ?
C’est la fonction de la lettre, qui « dessine le trou dans le savoir » (Lacan dans « Lituraterre »). Il précise aussi que le signifiant, c’est du symbolique, et la lettre, du réel. Ce n’est pas anodin ! L’écriture ne cesse de serrer le réel rencontré. Mais ce réel, en tant que tel, ne cesse pas de ne pas s’écrire, et appelle toujours à l’élaboration. C’est en quelque sorte mon sinthome ! (rire), mon virus, en somme, comme le dit joliment Bernard Seynhaeve. Écrire sans cesse, du lieu qui « ne cesse pas de ne pas s’écrire » ! (rire).
Si je peux ajouter un mot, la joie va au-delà de la satisfaction. Ce n’est pas la même chose, et c’est la différence entre la boucle 2 et la boucle 3 que vous évoquiez tout à l’heure (p. 181). On pourrait dire que la boucle 2, c’est une production d’un nom de jouissance, mais que la boucle 3 fait coupure par rapport à ce nom de jouissance, et c’est une grande ouverture du champ du désir. La différence est là.
V.C. : Formidable ! Ce n’est pas Boucle d’or, mais boucle 1, boucle 2, et boucle 3, et elle sort par la fenêtre (rire).
E.L.-R. : Oui, c’est ça même ! Quant à « analyste-femme », il y a aussi des choses à dire là. Je le reprends dans mon livre au chapitre « Féminité » (p. 151). La féminité se définit de n’être pas-toute prise dans le phallique. Si La femme n’existe pas, les femmes, elles, existent ; « Elles sont les meilleures analystes… les pires à l’occasion », dit Lacan. À ne jamais oublier. La marge est étroite. Cette précision qu’il donne est majeure pour ne pas tomber dans les pires : « C’est à la condition de ne pas s’étourdir d’une nature anti-phallique, dont il n’y a pas trace dans l’ICS. » (Le Monde, 2§/1/80]. C’est très important de le rappeler : le « toujours analysante », il est là.
V.C. : Analyste-femme, ça peut sembler délirant. Je pense à Antonio di Ciaccia à qui cette femme demandait une analyse en tant qu’il était un homme, parce qu’elle en avait assez de son analyste femme, et qui lui répondit en caressant sa barbe : « Qu’est-ce qui vous fait croire que je suis un homme ? »
E.L.-R. : Lacan l’avait déjà dit… peut-être à lui ! (rires)
V.C. : On entend le …ou pire dans ce que Lacan dit là des femmes. À croire qu’il y aurait le droit chemin, une orthodoxie, on peut faire des dégâts. C’est très grave. Parce que si chacun a à rencontrer son bout de réel, quand on s’autorise en tant qu’analyste, dans cette « fraternité discrète », il y a quelque chose qui peut mener au pire, du côté de l’empathie, ou de l’identification ?
E.L.-R. : Oui, question délicate. Je le dis dans mon livre : le réel ne se partage pas. La solitude vient là. C’est pourquoi je reviens à nouveau à cette question de la joie. La joie, ne serait-ce pas aussi l’effet de la fonction de l’écriture ?
V.C. : Vous parlez du temps 3 de l’analyse p. 193…
E.L.-R. : Il s’agit d’une troisième tranche d’analyse : « Tu veux savoir, alors tu vas savoir ! » Il apparaît nettement que le désir de savoir est lié de façon indestructible au « je n’en veux rien savoir ». Je suppose que c’est là que ça résonne pour vous avec cette question que vous ont posée un jour vos enfants.
V.C. : Oui, mes enfants me demandaient : « Y a-t-il une vie après la psychanalyse ? » Que leur répondriez-vous ? C’est un fait que mes enfants peuvent rire de leur mère, mais lorsqu’ils ont besoin d’une adresse pour un ami, ils savent aussi les adresser à moi. On se méfie chez nous du sérieux, lorsqu’il n’est pas sé-rire. Le sérieux ferait penser au tueur en série, alors que le rire peut avoir quelque chose d’impromptu. Et vous, que leur diriez-vous ?
E.L.-R. : Moi je leur dirais : « Oui, il y a quelque chose : la psychanalyse !!! », avec trois points d’exclamation.
V.C. : Vous seriez d’accord qu’on s’arrête là ?
E.L.-R. : Pour l’interview ? Vous voulez rire ! Il faudra en faire une deuxième alors… Je ne vous ai pas répondu sur le Witz. Peut-on aller jusqu’au Witz… ? Mais il y avait plein d’autres points encore.
V.C. : J’adore l’anecdote de votre Witz en voyant la photo de Lacan : « Oh l’amant de ma mère ! », p. 193. J’aimerais savoir comment le Witz a été reçu. Dans l’ouvrage Qui sont vos analystes ? ;, plusieurs analystes racontent qu’ils sont devenus analystes pour tenter de saisir quelque chose d’un rire les concernant, dans l’enfance, et auquel ils n’ont rien compris. Ça les avait surpris, cette blague dont la famille riait, mais pas eux.
E.L.-R. : La question de la féminité de ma mère, peu visible apparemment, a été très vive dans mon trajet analytique. Ça a été une grande découverte pour moi. Je peux juste vous en transmettre un petit éclair : un jour une de mes filles, bien adulte, entre dans mon bureau et s’arrête devant l’encadrement d’une très belle photo de Lacan près de mon fauteuil. Elle me dit, ironique : « La photo de ton amant ?! » Je lui réponds du tac au tac : « Mais non ! L’amant de ma mère ! » C’était sans aucune préméditation ! Surprise et rires. La psychanalyse était bien dans mon biberon, à l’insu même de ma mère.
V.C. : En disant ça, vous dites aussi autre chose : que c’est peut-être Lacan votre père…
E.L.-R. : Oh, cette fantaisie vous appartient… Restons plutôt à la question que vous soulevez, du rire, quand je l’ai raconté en analyse…
Avec ce livre, il s’agit de la voie/voix de ces traces, traces de vie, où :
[…] nous cherchons le gué
Dans les contours blessés de la parole
Dans la brèche du rire
Dans l’héritage des Tambours
(Ernest Pépin, Boucan de mots libres)
Poésie pure qui ouvre le livre de Raphaël Confiant, Ravines du devant-jour, qui a écrit sur L’avant-dire de la vie
C’est exactement là que j’ai rencontré Lacan…
Ou plus exactement que je l’attendais !
V.C. : Ou qu’il vous attendait.
E.L.-R. : Si vous voulez. Mais je l’attendais, parce qu’à s’approcher de l’avant-dire de la vie, ce n’est pas tout rose.
V.C. : Ce que vous avez réussi à transmettre là, avec ce travail qui vous caractérise, c’est remarquable. Vous êtes jusqu’à aujourd’hui la première à avoir pris ma demande à ce point de sérieux-là, allant jusqu’à réécrire mes questions et vos réponses. C’est votre style.
E.L.-R. : Oui, écrire encore ! Serrer le réel en jeu oblige à la rigueur. J’avais noté qu’un savoir était en attente que seul ce qui le trouait révéla. Je voulais tenter de transmettre au plus près, quelque chose de ce trajet. J’ai repris à mon compte cette citation de Lacan, qui dit si bien mon projet d’écriture :
Je ne noterai que le moment que j’ai recueilli d’une route nouvelle
À la prendre de ce qu’elle ne fut plus comme la première fois interdite.
Et j’y suis allée !
Le « trou dans le savoir », je l’ai rencontré dans la vie. C’est cette répétition d’une « rupture de l’être » qui m’a conduite à rencontrer un psychanalyste lacanien, grâce à un professeur de philo qui nous parlait de Lacan… et de son analyse avec un lacanien.
V.C. : Donc vous étiez très jeune quand vous avez entendu parler de Lacan, et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde. On peut dire aussi que Lacan vous attendait aussi, en passant par la bouche du professeur de philo.
E.L.-R. : Lacan n’avait pas besoin de moi, mais moi, j’avais fort besoin de lui !
V.C. : Je n’en suis pas si sûre. Parce que s’il n’y a pas d’analysant qui vient interroger quelque chose du désir de l’analyste, il n’y a pas d’analyste.
E.L.-R. : C’est sûr !
Avec un grand merci à vous, Violaine, pour cette interview si vivante… qui m’a fait beaucoup travailler !
V.C. : Mes remerciements à Jean-Christophe Contini, qui a édité ce texte.
*On peut se procurer Trace de vie/écriture (Élisabeth Leclerc-Razavet, Paris, 2023) :
ECF Echoppe / Place des libraires ou
***
Hors interview :
« Cette solitude, elle, de rupture du savoir […]
Est même ce qui s’écrit par excellence »
J. Lacan.