Je suis ce que je dis : choix, rejet ou déni de l’inconscient ?
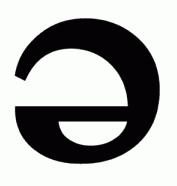
Maria Bolgiani, AME, est membre de la SLP, Scuola Lacaniana de Psicoanalisi, et de l’Association Mondiale de Psychanalyse.
Conversation avec Maria Bolgiani, 30 avril 2022, à Torino.
Violaine Clément : Merci Maria Bolgiani d’avoir accepté cette conversation, qui a lieu le dernier jour des restrictions COVID en Italie…
Maria Bolgiani : (rires) On n’est jamais sûr !
V.C. : Le pire n’est pas certain… (rires) C’est depuis que tu as présenté en janvier le chapitre du séminaire XIV de Lacan sur le Cogito, et qu’ensuite, j’ai entendu Jacques-Alain Miller à Question d’École parler du cogito moderne, je suis ce que je dis, que j’ai eu envie d’avoir cette discussion avec toi.
M.B. : En effet, je crois que cette idée de Miller de proposer ce nouveau cogito est vraiment géniale, c’est un thème fantastique de travail. Et donc, il y a quelque chose qu’on rencontre très souvent dans la clinique. Hier, lors de la conférence de Véronique Voruz à Turin sur la question de l’identité,1on a entendu parler de ça. Mais dans d’autres occasions aussi, il y a une façon d’être du sujet, pour autant qu’il y ait du sujet…
V.C. : Oui, c’est la question. Y a-t-il vraiment du sujet ? ce que nous a dit Véronique, parlant du sujet trans qui serait le sujet trans-subjectif, c’est que ce n’est pas la même chose que le sujet au sens de sub-jectum, dessous. On pourrait dire aujourd’hui que le sujet est dessus. Donc ce n’est pas un sujet. Ce n’est pas non plus un objet, puisqu’il serait alors en face, contre. C’est un je(t), jeté.
M.B. : C’est un je, en effet ! On ne peut pas dire, d’un côté, qu’il y ait du sujet, dans cette affirmation : je dis ce que je suis. D’autre part, c’est une des façons des sujets modernes de se dire. Même s’il n’y a pas, d’une certaine façon, de sujet, c’est un je, du côté du moi. C’est une façon qu’a le sujet contemporain de dire quelque chose de soi. Nous n’avons pas à dire que ce n’est pas bien, nous devons faire avec ça.
V.C. : Tu l’as bien, dit, faire avec ça. Dans le dire : Je suis ce que je dis, le ce fait penser au es freudien, de Wo es war, soll Ich werden. Dire qu’on est ce qu’on est, ce n’est pas encore je. Je trouve cette question de grammaire très intéressante. On dépasse la division entre névrose et psychose, on pourrait dire : tous psychotiques, ce que Jacques-Alain Miller avait déjà dit, voire tous schizophrènes ! Il n’y en aurait que quelques-uns qui seraient un peu plus mal à l’aise, ceux qu’on appelle les névrosés, empêchés, tandis que celui qui dit : je suis ce que je suis, dit en même temps : et vous, taisez-vous ! Il n’est pas très empêché, il n’a pas beaucoup d’inhibition.
M.B. : C’est vrai, en effet ! Et donc, est-ce qu’il y aura encore des gens qui feront appel à la psychanalyse ? Bon, il y en a encore, et il y en aura, mais c’est vrai que quand quelqu’un affirme : je suis ce que je dis, il n’a pas beaucoup d’interrogation. Il dit en effet : je sais ce que je dis, je sais comment je jouis, et l’autre n’a qu’à le reconnaître. Le reconnaître, ce n’est pas en tant que sujet…
V.C. : … le reconnaître, ou simplement, se taire. C’est quand même très surprenant et très nouveau, cette question. J’ai pu interroger un homme qui se transforme parfois en femme[2]… Mais la différence sexuelle existe pour lui.
M. B. : C’est très intéressant, parce que ça nous demande d’être à l’heure, avec nos catégories, notre génération, notre formation même, même en tant que psychanalystes, nous sommes désorientés.
V.C. : C’est nous, psychanalystes, qui sommes déconnectés, à côté de la plaque !
M.B. : C’est comme ça en effet, parce qu’il y a beaucoup à apprendre de ces sujets. Ce ne sont pas des sujets qui interrogent. Le sous-titre des journées d’automne est intéressant aussi : déni de l’inconscient. Il y a quelque chose comme ça. Et il faut tenir compte de ce déni de l’inconscient. Je me demandais quelles sont les conditions pour que quelqu’un, quand même, fasse appel à la psychanalyse. Je crois qu’il y en a.
V.C. : On peut se demander si ce n’est pas, comme souvent dans la psychose, au psychanalyste de soutenir le transfert, la demande, pour que surgisse du sujet. Miller a voulu il y a quelques années faire une journée sur le parlêtre, mais ça n’avait pas pu se faire. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, ces journées sont clairement orientées par le parlêtre.
M. B. : Intéressant !
V.C. : Je parle, et vous allez m’entendre ! C’est pour cela que j’ai proposé à deux jeunes femmes trans de me parler, c’est moi qui leur ai demandé.
M.B. : C’est vrai que ça donne la possibilité de parler. Et quand on parle, on peut rencontrer quelque chose de subjectif. C’est une position d’élaboration, il me semble Ce n’est pas qu’ils.elles doivent changer, mais cela peut permettre un peu de dialectisation.
V.B. : C’est vrai que dialectiser sa position, c’est précisément ce que le sujet contemporain ne veut pas. C’est fatiguant.
M.B. : Ce sous-titre du déni de l’inconscient m’intéresse beaucoup, parce que je pense à mon travail comme psychiatre dans un centre hospitalier. Le déni de l’inconscient, c’est avant tout le fait des psychiatres, qui nient l’existence de l’inconscient. C’est aussi difficile pour des jeunes, je ne dirais même pas des patients, parce qu’ils n’arrivent parfois même pas à être des patients, encore moins des analysants… Mais quand il y a un malaise, un symptôme, qui n’est pas forcément leur position, mais quand quelque chose se produit, ils rencontrent des gens, de leur côté, en tant que médecins, en tant que psychiatres, chez qui il y a un déni de l’inconscient. Ils n’ont dès lors aucune possibilité de faire un travail, de se mettre au travail, que quelque chose se modifie, vraiment. Ou bien, s’ils rencontrent quelqu’un qui leur donne un médicament, si le médicament marche, c’est bien, mais si le médicament ne marche pas, le psychiatre n’a aucune idée de ce qu’il doit faire, car il n’entend pas, il n’entend rien, et donc cette idée du déni de l’inconscient, Miller l’a dit aussi en parlant lors de cette conférence qu’il a faite par zoom en Russie, c’était d’une simplicité, d’une lucidité incroyable. C’était tellement ça, on prend les dits pour la vérité : ils disent la vérité, et le psychiatre ne s’occupe que de ça. C’est ce que je disais : si le médicament marche, ils s’en vont. Rien n’a été modifié, le symptôme va réapparaître, et si le médicament ne marche pas, comme ça arrive souvent, c’est une impasse complète, de la part des psychiatres. Donc je pense que c’est très intéressant, cette question.
V.C. : Ça veut dire que le psychiatre devrait, lui le premier, accepter d’être divisé, et faire son analyse.
M.B. : Oui, c’est difficile, surtout dans le moment que nous vivons. Les jeunes psychiatres sont formés dans une université où ils n’apprennent que le DSM. C’est fascinant. Donc, ils n’apprennent rien d’autre que le DSM, la liste des comportements, et n’ont pas la notion de la différence entre énoncé et énonciation, autrement dit entre le dit et le dire. Si quelqu’un demande à être aidé pour des problèmes d’argent, de famille, on croit qu’il dit la vérité, et on n’entend que ça. On cherche aussi, quelques fois, à aider les patients avec la famille, l’argent, mais ça va échouer, car ce n’est pas ça. Dans un service public, on peut aussi faire ça, mais si on n’a pas d’orientation, ça va échouer, car ce n’est pas ça.
V.C. : C’est l’humanitaire aux commandes.
M.B. : Exactement !
V.C. : Et l’humanitaire, ça fait taire le sujet ! C’est intéressant que toi, dans le service public, tu sois justement contente de cette orientation que nous donne Miller, qui nous donne de l’air.
M.B. : Exactement !
V.C. : Quand il nous dit d’être dociles aux trans, il nous propose plutôt d’y mettre du nôtre, comme Freud l’avait fait avec les hystériques.
M.B. : Ce qu’il nous propose, c’est d’être dociles au dire du sujet, c’est toujours la distinction entre le dit et le dire. C’est cette orientation, où il faut saisir le niveau de l’énonciation, sinon on ne peut rien faire, même quand on ne travaille pas comme psychanalyste. Même comme psychiatre. C’est l’impasse continue.
V.C. : La question de l’énonciation pousse à savoir qui parle, et à qui… Ce qui me surprend toujours, c’est à quel point cette position est toujours mal comprise…
M.B. : C’est ça. Il y a un texte de Lacan que j’aime beaucoup, c’est la question de la place de la psychanalyse dans la médecine3, en 1966, il avait une vision de la situation des médecins très prophétique. On n’y était pas encore, mais il décrivait ce qui est arrivé par la suite : le médecin est devenu pourvoyeur de gadgets de l’industrie pharmaceutique, qu’il distribue. Il n’a plus que ça à faire parce qu’il ne peut pas, il n’est plus en position de soutenir le transfert. C’est ça qu’il dit en effet, et ça dépend aussi de la formation des médecins, c’est la question, je crois. Ce que Lacan dit, c’est que le médecin avait une autre position auparavant, dans un monde où le symbolique avait une autre réalité, qui lui permettait en quelque façon de soutenir le transfert. Ce n’était pas le transfert de la psychanalyse, mais le patient confiait sa vie au médecin, en sachant que le médecin n’avait pas tout pouvoir de le sauver, mais quelque chose d’insaisissable était en jeu, des deux côtés, et donc le médecin pouvait mener une cure en sachant qu’il n’avait pas tout pouvoir, et en sachant qu’à un certain moment, il devait s’arrêter. Là, il mettait en jeu quelque chose de sa fonction, de sa formation, pas de sa technique, Lacan parle de sa mission, quelque chose comme ça, donc il soutenait une position, sa position, pas du côté de la technique. Et donc le médecin se trouve aujourd’hui en condition de n’avoir plus les moyens. Donc les patients, on les fait taire. Et aujourd’hui, dans ce symbolique-là, en effet, il n’y a que la psychanalyse pour sauver la médecine, en tant que médecine et pas seulement en tant que technique, d’une certaine façon. Parce que ce n’est qu’avec la psychanalyse, que, en tant que sujet, et pas en tant que médecin, un psychiatre peut assumer sa fonction. Pas dans la technique. Et c’est vraiment frappant.
V.C. : Autrefois, un médecin pouvait soutenir ce dire : je suis ce médecin à qui tu t’adresses…
M.B. : Aujourd’hui, quand le médecin ne sait plus quoi faire, il laisse tomber. Parce qu’il n’a pas d’autre moyen, parce que même la relation médecin patient, qui n’est pas le transfert analytique, il ne peut pas la tenir.
V.C. : Quand tu travailles, tes collègues voient comment tu travailles …
M. B. : Oui, ça c’est terrible, je travaille depuis 13-14 ans dans ce lieu, je crois que mes collègues ont confiance en moi, parce qu’ils voient que j’accepte très volontiers des patients considérés comme très difficiles, mais je ne suis pas du tout arrivée à transmettre quelque chose de ma formation. Tout reste centré sur ma personne : Maria est quelqu’un qui aime les patients difficiles. C’est une difficulté pour moi. Je ne suis pas arrivée à transmettre quelque chose de ma formation, parce qu’ils croient que tout ça me caractérise, que c’est lié à ma personne (rire).
V.C. : C’est une vraie question, cette question de la transmission. C’est aussi ce qui m’a interpellée à propos de la manière dont certains groupes de l’autre côté de l’Atlantique s’y sont pris pour intéresser des jeunes à leurs activités : ils les ont ouvertes à des jeunes lycéens, car ils ont constaté que c’est trop tard pour ceux qui commencent leurs études de psycho à l’université, ils sont pris par les TCC, la systémie etc… Penses-tu que ce soit possible en Italie, d’aller parler aux jeunes, avant l’Université ?
M.B. : Oui, c’est intéressant. Il faut avoir aussi à l’horizon la psychanalyse, mais plutôt comme une visée, de la même manière dont, en psychanalyse, on vise le sujet, pas le symptôme. On espère qu’il y aura d’autres psychanalystes (rires), et parler de la psychanalyse, qui pour nous est une joie, ça pourra peut-être s’entendre.
V.C. : C’est dans cette idée que nous avons peut-être une chance de faire entendre combien ça rend joyeux de s’entendre parler à un analyste. Ainsi ce Wo es war pourra-t-il se faire entendre…
M.B. : C’est passionnant, c’est un nouveau défi, et surtout, nous avons beaucoup à apprendre.
V.C. : En effet, l’inconscient existe-t-il avant que s’entende un lapsus, un rêve, un ratage, un rire ?
M.B. : La psychanalyse, c’est vraiment un possible ?
V.C. : Comment dit-on en italien : je suis ce que je dis ?
M.B. : On peut discuter la traduction : il y a : dico ciò che sono, c’est un peu plus lacanien que le plus courant : dico quello che sono. Nous, Lacaniens italiens, je pense qu’on parle un italien vraiment français…
V.C. : C’est la chance d’avoir plusieurs langues ; il est monolingue celui qui dit ce qu’il est. Il ne le dit que dans une langue, et il est seul à savoir ce qu’il veut dire. Hier, on entendait la difficulté de faire entendre en italien toutes ces catégories qui tournent autour du queer, qui font partie de cette nébuleuse.
M.B. : Ce qui me fait aussi travailler à propos de cette question trans, et que disaient aussi bien Véronique Voruz que Mary Nicotra, trans n’est plus un mot qui indique la transition, mais plutôt l’appartenance à ce spectre. En italien, on utilise le mot transversal, pour dire quelque chose qui couvre plusieurs champs. J’ai l’impression qu’en Italie, on utilise encore plutôt le mot trans pour ceux qui veulent changer de sexe. Une autre chose, le signe dont a parlé Mary Nicotra, ce signe qu’on utilise en italien, le schwa, pour dire ni l’un ni l’autre, ou encore pour dire toutes les possibilités. Parce que très souvent, en italien, les adjectifs se terminent en a pour le féminin et en o pour le masculin, mais pas toujours. L’idée serait de mettre un tel signe, neutre, inclusive de l’autre. Mais pour ce signe aussi, on ne sait pas s’il faut dire le ou la schwa (rire), parce qu’en italien, il n’y a pas le neutre. On retombe toujours sur cette question, le symbolique reste binaire, mais ce n’est plus la manière dont on peut faire face au monde, se confronter aux choses.
V.C. : En fait, ce qui est embêtant, c’est toujours la question du féminin. Quand l’organisation du monde, grammatical, faisait que le masculin en français l’emportait sur le féminin, pour simplifier, ça ne posait pas de question. Ce que rappelait Véronique hier soir, c’est que beaucoup de gens se disent trans… Se dire trans, c’est être à la mode…
M.B. : C’est vrai que c’est very cool… (rire). Mais en italien, il faut encore choisir entre masculin et féminin, le binarisme a une fonction. Le ou la chiffre (rire) de la jouissance, c’est toujours singulier, ça a à faire avec une lettre. Chacun sa lettre. Le choix est infini.
V.C. : Comment écrirais-tu sa lettre ? L’être ? (rire) C’est beaucoup plus difficile à l’époque où chacun doit faire son choix (son schwa), puisqu’on peut imaginer un nombre de lettres infini. Or dans la langue, le nombre est fini. Pendant longtemps, on laissait l’autre nous tamponner, nous dire notre lettre. Mais aujourd’hui avec le/la COVID, on nous redistribue : vacciné, pas vacciné…
M.B. : C’est intéressant : il y a une re-proposition de ce binarisme, mais ce n’est plus un binarisme symbolique, c’est complètement imaginaire. Là où le symbolique ne tient plus beaucoup, on introduit non pas un autre binarisme, mais une polarisation : c’est l’un ou l’autre, l’un contre l’autre. Donc le spectre, c’est beaucoup mieux, parce qu’il y a des possibilités différentes. Avec vaccinés/non-vaccinés, on a créé une polarisation en Italie, qui était absolument imaginaire. On a poussé les gens vers l’une ou l’autre, même quand les gens avaient des positions très nuancées. Là, en effet, le binaire du symbolique ne tient pas quand on crée une polarisation avec des factions, des groupes qui sont l’un contre les autres.
V.C. : Et le réel, alors, où est-il ? Ne fait-on pas tout ce travail pour éviter de se confronter au réel ?
M.B. : Le symbolique aussi, ce binarisme, a aussi pour fonction de voiler le réel, mais le voiler, ce n’est pas la même chose que de l’expulser.
M.B. : La psychanalyse s’invente, mais comment se transmet-elle ? C’est la question que nous nous posions tout à l’heure.
V.C. : Le virus se transmet bien plus facilement que la psychanalyse (rire)… Peut-être devrait-on s’enseigner de son mode d’action. C’est pour cela que notre blog, Le virus de la psychanalyse, né du COVID, peut transmettre ailleurs des échos de ce savoir-y-faire propre à toi, à vous, ici, à Turin. Je t’en remercie.
M.B. : Merci à toi, c’était très intéressant…
Notes:
- Référence à la conférence organisée par la SLP – Secrétariat de Turin, le 29 avril 2022, avec le titre Non sono né l’una né l’altro, sono altr*. Intorno a identità, fluidità, linguaggio. ↑
- Clément, V. « Le spermatozoïde et la sirène« . ASREEP-Blog. ↑
- J. Lacan. « La place de la psychanalyse dans la médecine », dans Le Bloc-Notes de la psychanalyse, n° 7, Georg éditeur, p. 9-40. ↑
