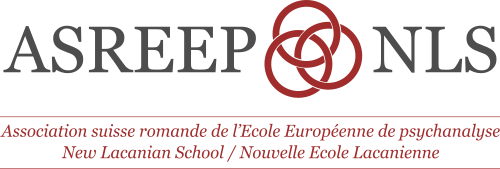La poésie, pas le tourisme

Conversation avec Hadrien Praz, le 3 avril 2025, dans mon cabinet, rue de Lausanne.
Violaine Clément : Hadrien, au beau nom, avec H, évidemment, tu es le fils de mon ami Albert, mon professeur de grec et parrain de mon fils et aussi de mon amie Claire, et tu vis en Valais. Tu as vingt-neuf ans, (juste pas trente) et tu es l’auteur de ces nouvelles qui m’ont beaucoup fait rire… et pas seulement, parce que le rire n’est jamais tout à fait innocent. Nouvelles qui ont paru aux éditions de l’Hèbe, et pour lesquelles tu as remporté un prix.
Hadrien Praz : Oui, c’est ça. C’était dans le cas d’un concours pour un premier roman, mais du coup, roman, au sens large, parce que là, c’est un recueil de nouvelles, et on était quatre à gagner ce prix. Le prix, c’était d’être publié, une première publication à notre nom. C’était une occasion pour moi de faire naître ce petit (rire).
V.C. : L’accouchement a-t-il été douloureux ?
H.P. : Il a été, disons, discontinu : c’est un recueil de nouvelles écrites sur plusieurs années, dans différentes circonstances. Certaines plus récentes, d’autres plus anciennes. Et je me dis que j’ai quand même évolué depuis, en comparant les plus anciennes et les plus récentes. Mais elles ont quelques liens communs.
V.C. : J’en ai trouvé en tout cas un de lien, c’est la Suisse (oui !). Un autre, c’est la forêt c’est vrai, toujours là, un peu angoissante quand même (rire), et pour qui s’intéresse à la psychanalyse, tu fais montre d’un imaginaire floride. Tu as toujours eu ça ?
H.P. : Oui. Enfin, ça dépend, par quoi tu veux que je commence ?
V.C. : Ce que tu veux.
H.P. : D’accord. Alors la Suisse. J’ai un rapport un peu compliqué à la Suisse. À la fois, quand j’étais petit, c’était un pays qui m’énervait, qui m’ennuyait. Je me disais que je préférerais être Anglais, Italien… (tout sauf Suisse !) Parce que ça m’apparaissait un peu plan-plan… En grandissant, je me suis dit : « Bon, je suis Suisse, je ne peux pas changer ça, c’est un peu mon identité, même si j’ai de la famille aussi un peu ailleurs ». Et en même temps, ce pays me fascine. J’ai commencé à m’y intéresser, à m’intéresser à ce qu’il propose comme modèle, comme idée, comme concept. Donc maintenant, je suis plutôt dans une posture d’intérêt, de fascination pour la Suisse.
V.C. : Fascination, tu le sais certainement, fascinus est le sexe masculin en érection…
H.P. : C’est vrai (rires) ?
V.C. : C’est cet objet apotropaïque, qui sert aussi pour éloigner le mauvais sort… Cette fascination, chez toi, passe d’abord par le rejet, le refus.
H.P. : Oui, tout à fait, par le refus… et finalement, je suis très content d’être Suisse, de ce point de vue-là… En tant que citoyen, je suis très privilégié d’être Suisse, pour toutes sortes de raisons, mais je suis aussi très intéressé, parce que c’est un pays qui pour moi propose quelque chose de spécial, de différent.
V.C. : Tu peux en dire un peu plus ?
H.P. : Oui, je trouve que d’autres pays, la France, l’Allemagne, proposent un roman national. De grosses narrations historiques, avec des héros. Et la Suisse, c’est comme si elle s’était construite un peu par opposition à ça. On va plutôt revendiquer une forme de modestie, ni trop ni trop peu, une forme d’invisibilité. On a Guillaume Tell, et c’est un peu tout… Comme histoire fondatrice, c’est très pauvre.
V.C. : Oui, on est un pays pauvre, et on passe pour un pays riche. C’est un pays très contradictoire.
H.P. : C’est très contradictoire, comme pays. Exactement ! Et sur plein de points. Mais notamment cela : c’est un pays qui s’est construit par le compromis, de gens qui ne se ressemblaient pas forcément, de religions différentes, de langues différentes… Il y a ce côté compromis, il y a aussi ce côté complexe d’infériorité par rapport aux voisins, et en même temps, complexe de supériorité aussi. On dit souvent en Suisse romande des Français qu’ils sont désorganisés, qu’ils sont de « grandes gueules », et en même temps, on se dit que c’est aussi eux qui ont inventé la langue que nous parlons… Il y a plein de points que je trouve très intéressants. J’ai eu la chance d’avoir à l’Université un professeur qui nous parlait de la littérature suisse du XVIIIe siècle, sujet très peu connu. Il nous disait comment la Suisse s’est construite culturellement comme un paradis pour les gens de l’étranger, où l’Histoire ne s’écoulait pas, une sorte de creux du temps, quelque chose d’un peu intemporel. Je me dis que le paradis, c’est beau, mais on peut s’y faire un peu « chier » aussi (rire).
V.C. : Tu parles souvent de l’ennui (oui !). Encore une fois, étymologiquement, l’ennui, c’est in-odium, en haine. On pourrait donc haïr ce pays, ou l’adorer, être fier d’être Suisse. Deux positions tout aussi ridicules l’une que l’autre. Accepter de s’interroger, comme le fait David Castello Lopes1, qui est très drôle en se moquant de nous, avec affection.
H.P. : Oui, j’aime beaucoup !
V.C. : C’est aussi la position que je vois dans tes personnages, qui font rire, et qui sont émouvants, et qu’on a envie de consoler parfois parce que ce qu’ils vivent est parfois violent.
H.P. : Oui ! Ça, c’est un thème que j’aime bien : introduire de la violence dans ce monde assez calme, dans ce monde si tranquille où, si la violence existe, elle est cachée, on n’en parle pas trop… Du coup, je m’amuse, ce que permet la position de l’écrivain. Parfois très gratuitement, en faisant tomber une météorite (rire).
V.C. : Tu t’amuses comme dans un jeu vidéo. Cela me rappelle que le fils du concierge venait dans mon bureau, à mon insu, jouer sur mon ordinateur à construire des villes… Je ne comprenais pas pourquoi j’avais tout ça sur mon ordi, alors je lançais des orages, des incendies, des tornades… Il n’avait pas trop aimé. S’il se permettait de venir dans mon bureau, je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas moi aussi m’amuser…
H.P. : Absolument. Souvent, le plaisir de construire, c’est aussi le plaisir de détruire, après…
V.C. : Avec les élèves aussi, il m’est parfois apparu que ceux qui avaient tout cherchaient à détruire, et inversement, ceux qui n’avaient rien cherchaient à construire… C’est la question de la frustration. Tu es né dans un milieu très aisé intellectuellement. Tu aurais pu vouloir le détruire…
H.P. : Là aussi, je suis un peu ambivalent. C’est une chance énorme d’être né dans ce milieu-là, très intéressé par la littérature. Mes deux parents sont des amoureux des lettres, des livres, de la littérature. En même temps, j’aime bien être un peu iconoclaste, et gratter dans les endroits inattendus, et explorer des zones un peu bizarres.
V.C. : Tu sais que tous ceux qui viennent parler, Lacan le disait déjà, pendant longtemps, parlent de papa et maman (rire)… en général pour s’en plaindre. Jusqu’au moment où ils se rendent compte que ce monsieur et cette dame ont fait ce qu’ils ont pu. Tu y arrives sans avoir fait d’analyse. Vouloir un peu détruire, c’est quelque chose que tu as depuis longtemps ?
H.P. : Oui… Comment dire ? Écrire, ça permet de décharger une dose d’agressivité et de violence. Moi, dans la vie, je suis plutôt quelqu’un de pacifique, de poli, de tranquille, de bien élevé. Comme le sport et d’autres pratiques, l’écriture permet de décharger. Je trouve salutaire de trouver une pratique ou une autre où on puisse exprimer, sans violence à l’égard des autres, quelque chose qui bouillonne.
V.C. : Il y a en effet des phrases que je ne voudrais pas citer, mais celle-ci : alors qu’elle se faisait sucer le cerveau, Psyché s’interrogeait (rires). On est parti. Ou celle-ci : Un jour, j’étais l’ami de X. Tout à coup, il est mort. Point ! On a deux phrases. Et puis : C’est alors que je me suis dit : Mais comment X est-il mort ? (rires) Il y a dans ton style quelque chose du coup de poing.
H.P. : Oui, j’aime bien, j’essaie parfois. J’aime bien la sécheresse du style. Les choses qui arrivent plus vite que dans la vie, où souvent il faut attendre. J’aime bien ce pouvoir des mots où tu peux en deux phrases dire : quatre ans plus tard, après la guerre… (rire) C’est une prise qu’on n’a pas sur le temps de la réalité, et je trouve magique que, dans l’art de la narration, on puisse avoir ce pouvoir-là. Donc je ne m’en prive pas.
V.C. : Et c’est extrêmement réussi, pour moi. Et je ne crois pas que je sois bêtement enthousiaste. Il y a des choses qui m’ennuient profondément, mais quand ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Ce qui m’a surprise, ce sont mes éclats de rire à la lecture de Mathilde. On est d’accord, il y a du Alice au pays des Merveilles dans ce melting pot de contes que tu fais se confondre. Ancien ou récent, ce récit ?
H.P. : Relativement ancien, je dirais. J’étais à l’Université, j’ai eu des cours très intéressants sur les contes allemands. Et en même temps, on avait aussi des cours sur les contes russes. Là, j’ai commencé à me fasciner pour les contes, qui sont aussi un objet de fascination pour les psychanalystes. Il y a tellement de côtés qui m’intéressent. Ce texte, effectivement, il est drôle, comique, mais je crois que c’est aussi le texte le plus violent du recueil. Ce qui me choque dans les contes, c’est l’éternel retour de la violence sur la protagoniste, souvent des femmes… Dans les contes de Grimm, c’est souvent une fille, qui paie très cher. Ou si on pense à La petite fille aux allumettes d’Andersen, c’est horrible. C’est souvent des textes d’une violence totale, pour mettre en garde contre la violence du monde. Là, je voulais pousser la logique, un peu sadiquement, je le voulais (rire), pour dire : ça peut être infini… Il y a aussi cette structure du conte, qui se répète, qui se répète…
V.C. : Tu as raison, c’est non seulement infini, c’est tout et son contraire, tu le dis bien, cela ne s’arrêtera pas. Parce que c’est aussi ce mouvement de la vie. Il n’y a pas de vie sans la mort, et pas de mort sans la vie. Là, tu le déploies… jusqu’à ce mariage avec sa mère (rires). On a l’impression que tu fais du judo avec le lecteur. Ça m’a parlé d’autant que ça consonne avec mon prénom, Violaine, ce dont je me suis rendu compte tardivement. Il y a chez toi un amour du féminin, rare. Comme chez Elfriede Jelinek, dont nous parlait notre collègue, la vie se mêle à l’œuvre ; as-tu l’impression que c’est plus dur, la vie, pour une fille ?
H.P. : Oui, je pense, quand même.
V.C. : Dans ta famille, toi qui as deux frères, il n’y a de femme que ta mère…
H.P. : Complètement. D’ailleurs, je suis assez mal placé pour me prononcer sur ces questions ; enfin, je me sens mal placé, parce que c’est inimaginable pour moi, l’expérience d’une femme.
V.C. : Je ne suis pas sûre qu’une fille soit mieux placée. Quand on dit que la femme est autre à elle-même, tu crois qu’elle serait mieux placée ?
H.P. : Elle est mieux placée quand même. C’est juste que je veux éviter la position paternaliste.
V.C. : Tu fais partie de cette génération où on n’a pas le droit de parler, quand on est un homme, du côté des filles…
H.P. : C’est peut-être la version caricaturée, mais il y a un peu de ça. L’idée, c’est d’éviter de parler à la place de l’autre.
V.C. : Tu ne peux en effet parler que de ta place. Mais en tant qu’écrivain…
H.P. : Oui, je peux tout faire…
V.C. : C’est comme dans l’inconscient. Quand tu fais un rêve, tu es à toutes les places. Tu es aussi bien celui qui rêve que celui qui se réveille et qui dit : C’est pas moi (rire) ! Il y a de l’inconscient dans l’écriture.
H.P. : Bien sûr, et je m’en suis servi. Je note mes rêves, c’est une matière très riche, et très drôle aussi. J’aime bien aussi retourner le cliché littéraire qui fait de la femme un être instinctif, au contraire de l’homme qui serait un être rationnel. Quand j’écris des femmes, dans ces recueils, c’est au contraire des êtres très rationnels. Dans l’un de ces récits, il y a une organisatrice, qui est vraiment très dans sa tête. Il y a aussi un récit sur Amour et Psyché, et là, pour le coup, dans le mythe, Psyché, c’est l’esprit, l’intelligence, et Amour, c’est plus pulsionnel, physique. C’est comme ça que je le vois.
V.C. : C’est drôle, parce qu’on a un congrès prochainement sur les Amours douloureuses, et pour moi, dans Éros et Psyché, Éros est le gamin mal élevé, gâté, c’est aussi comme ça que tu le présentes, mais il est aussi un peu veule. Il n’a pas plus le contrôle de ses choix que Psyché. Tu te permets, en mythologue comme dans les contes, de mélanger les genres. C’est ça la poésie, c’est iconoclaste, ces personnages n’appartiennent à personne.
H.P. : Oui, je laisse faire les personnages. Psyché, je l’ai pensée aussi comme une personne traversée de fantasmes, très mégalomane. À la fois martyre totale, et en même temps seulement digne des dieux ou des déesses. Le monde des fantasmes, très exagérés, cela m’amuse, c’est quelque chose que je porte.
V.C. : Avant, tu parlais de psychothérapie, on entend Psyché, et je fais toujours une grande différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. La thérapie, ça a à voir avec le grec therapeuein, qui signifie honorer, soigner les dieux. On crée des dieux, méchants, et il faut les empêcher de l’être encore plus ; donc il faut leur construire des temples, leur apporter des cadeaux… Psyché, c’est aussi le souffle, le souffle vital. La psychanalyse a pour objectif de casse le mégalo. Ainsi, en cassant le mégalo-mane, on peut redevenir simplement un Mann, un homme. On peut vivre avec l’autre. Le problème, c’est que ce n’est pas pour tout le monde. Actuellement, la psychanalyse est très mal vue. Qu’as-tu pensé quand je t’ai proposé cette conversation ? As-tu craint ?
H.P. : Non, c’est vraiment l’inverse. Quand j’ai relu ces textes, je me suis dit : « Ah tiens., ça peut plaire à un psychanalyste », sans en savoir grand-chose. J’ai toujours eu un œil amusé, ou plutôt intéressé, pour la psychanalyse. Notamment quand j’étudiais les contes. J’ai lu des psychanalystes sur Barbe Bleue, notamment, et je trouvais ça intéressant.
V.C. : Dans Barbe Bleue, en effet, toutes les ex sont gardées embaumées et la dernière épouse reçoit une clé qu’elle n’a pas le droit d’utiliser. C’est fou, quand même !
H.P. : C’est de la perversion totale !
V.C. : Qu’est-ce qui fait qu’une femme accepte ce deal, et puis s’en plaigne ? (rire)
H.P. : Mais en même temps, c’est la preuve de confiance la plus immense, de confier à quelqu’un la clé vers les pires de ses secrets. J’aime bien cette interprétation. Il y en a d’autres, du côté de la perversion. Mais celle du côté de la preuve d’amour, de confiance… Je te donne cette clé et je sais que tu m’aimeras assez… Mais non ! (rire)
V.C. : J’aurais l’idée que la perversion, dont on parle très peu actuellement, on parle beaucoup de psychose, de névrose, or si le pervers est celui qui a besoin d’un autre pour jouir, une femme qui a besoin d’un homme qui la frappe, qui lui fasse n’importe quoi, elle est perverse. L’homme, ce pauvre gnaque qui se laisse attraper, s’il a besoin de parler, il va trouver un analyste, non ? Qu’est-ce qui le fait porter à sa jeune femme la clé du plus horrible de lui ?
H.P. : C’est du pragmatisme !
V.C. : C’est ce qui fait que nous parlons plutôt de la fille père-versement orientée, c’est-à-dire tournée vers le père. Il y a chez toi une veine qui va dans ce sens, d’un jeu avec les mots.
H.P. : Oui, j’aime bien rebondir, j’aime les interprétations un peu délirantes. Ainsi chez Barbe Bleue, le sang sur la clé, est-ce que ce ne serait pas aussi le sang des règles ? Elle qui découvre une part sombre de son destin sexuel ? Elle, vue comme un objet par un homme ? Je trouve qu’il ne faut s’interdire aucune piste. J’aime bien ce côté ludique, que j’ai trouvé aussi dans quelques textes psychanalytiques que j’ai pu lire. On prend des pièces et on les assemble de façon à créer un narratif qui parle, qui ait du sens.
V.C. : S’il n’y a pas d’interdit dans le jeu que tu fais avec les morts, il y en a un dans la façon de te comporter dans le réel. Tu ne ferais pas ce que tu dis. Si quelqu’un ne fait pas cette différence entre un rêve, ou un écrit, et la réalité, on l’enferme. Il y a beaucoup de gens psychotiques dans les prisons, qu’on n’a pas voulu entendre quand ils disent leur vérité, vérité qu’ils mettent en acte.
H.P. : La frontière entre la fiction et la réalité est pour moi très importante. Il y a des pratiques qui, lorsqu’elles sont dans les limites codées, donc dans la fiction, sont sympathiques, acceptables, drôles. Au théâtre, puisque je fais un peu de théâtre, j’aime bien jouer des personnages un peu violents, qui ont des défauts, qui sont irascibles… Alors que dans la réalité, je n’aime pas du tout ça. Ça m’amuse beaucoup quand il y a un cadre fictionnel.
V.C. : C’est cathartique. On faisait sur la scène des choses dont on ne voulait pas dans la réalité. J’ai l’impression qu’aujourd’hui on a un peu oublié cet écran. Alors qu’il y a des écrans partout, on pourrait dire que ça crève l’écran. On croit que ce qu’on voit, c’est vrai. Il y a parfois, certes, un fou qui passe à l’acte, qui fait son jeu vidéo dans la nature. Mais c’est beaucoup plus rare que de voir une foule de gens qui se mettent à jouer un rôle dans la vraie vie, comme Trump – ou d’autres allumés – quand il joue au président, comme on le voit signer ses décrets, comme dans une série télé. Ton usage de la plume est différent du sien. On voit bien avec ce retour des incels le désir d’empêcher la diversité, en commençant par empêcher l’usage du mot. C’est angoissant de voir se réaliser cette inversion entre la fiction et la réalité.
H.P. : Oui, il y a un débordement malsain, un passage devant l’écran de ce qui était derrière, avec la chute du quatrième mur, qui est cassé. Mais sur la figure du mâle, viril, donc (tu l’as tout de suite entendu !), il y a une façon très peu imaginative, et très peu cultivée, d’envisager la vira, heu, la virilité… (rire)
V.C. : Ce lapsus est formidable : la viralité pour la virilité. Tu as raison, ça m’a aussi toujours fascinée, au point que j’ai cherché pourquoi nous avions appelé ce blog le virus de la psychanalyse. Virus2 mot neutre, consonne avec vir (l’homme), viral avec viril, mais si ça consonne en latin, ça ne vient pas du tout de la même racine : virus vient de quelque chose d’un peu dégoûtant. De même que βίος, bios (masculin) et βία (féminin) désignent en grec la vie et la violence, il y a dans ce rapprochement phonique quelque chose de parlant.
H.P. : (rire) En français, les deux sont féminins !
V.C. : Et en russe ? Langue que tu as apprise avec ta mère ?
H.P. : Un petit peu, j’en ai fait dans le cadre de mon bachelor à l’université, mais j’ai un peu tout oublié, malheureusement…
V.C. : Lacan écrivait lalangue celle de la famille. La langue, c’est celle de l’autre, mais pour savoir qu’on en a une, il faut en avoir d’autres. C’est parce qu’on apprend une deuxième langue qu’on se rend compte que la sienne n’est pas la langue de tous. Ça devrait nous empêcher de devenir totalitaires. Dirais-tu que le passage par le russe, et par d’autres langues…
H.P. : J’ai fait de l’allemand à l’université aussi, et un peu d’anglais comme tout le monde.
V.C. : Pas tout le monde a fait autant de langues (si on ajoute encore le latin et le grec) !
H.P. : Oui, mais à un niveau assez bas. Honnêtement, moi, c’était plutôt les littératures allemande et russe qui m’intéressaient.
V.C. : C’était quoi dans les littératures ?
H.P. : Plutôt Kafka, dans l’absolu. Je trouve que c’est vraiment un des meilleurs. Lui a vraiment une écriture de ce qui est cauchemardesque. Il arrive à le mettre en littérature de façon parfaite, et puis, chez les Allemands, j’aime bien, il y a beaucoup de fous en littérature, des auteurs un peu toqués, radicaux dans l’écriture de ce qu’il y a de sombre.
V.C. : Tu pourrais en citer ?
H.P. : Par exemple, il y a Kleist, je ne sais pas si tu vois… (non, mais ça m’intéresse), qui écrit des trucs angoissants, mais au début du XIXe siècle. Il s’est suicidé, et puis il a été extrêmement précurseur. Il y a Georg Büchner, un auteur qui est mort à 24 ans. Que des auteurs qui meurent jeunes (rire) !
V.C. : Tu ne les choisis pas parce qu’ils meurent jeunes, quand même ?
H.P. : Ils n’ont pas eu le temps de vieillir.
V.C. : Ils sont morts par suicide tous les deux ?
H.P. : Alors lui, je ne sais plus. Peut-être bien (en fait, il est mort du typhus). Mais voilà, ce sont des personnalités qui ne sont donc pas des modèles de vie, du coup.
V.C. : Quoique… Savoir qu’on va mourir peut donner du goût pour la vie. Ce que Lacan rappelait3. La place que tu donnes à la mort dans tes nouvelles, bien qu’elle ne soit pas très réelle, indique aussi que ça peut s’arrêter, et donc soulager. On vit à une époque où il ne faudrait pas penser à la mort. Mais si on y pensait un peu plus, on vivrait peut-être un peu mieux. Il faut lui laisser une place.
H.P. : Peut-être que lui laisser une place, il y a ce côté tabou, parce que stagnante, effectivement…
V.C. : Ton Ours final, si ce n’est pas un appel à la mort, je n’y ai rien compris.
H.P. : C’est une très bonne interprétation. Pour moi, il y a le côté totem de l’ours, qui peut dire beaucoup de choses. L’idée c’est une entité qui surgit de façon un peu brutale, et souvent en effet, qui tue soit le texte, soit le personnage. Et c’est un peu la fatalité nécessaire. Tu as très bien interprété en disant que c’est la mort.
V.C. : Tu reconnais quand même que l’animal qu’on donne aux petits enfants, que ce soit un ours… Cela me fait penser à Pierre Encrevé, un linguiste, qui s’émerveillait du génie des enfants qui découvrent la parenté entre ours, nours, zours, tours… Un ours, des ours, cet ours… Les enfants apprennent très rapidement ce qui nous demande beaucoup de temps pour y mettre de l’ordre, et pour ne plus y voir la mort. Toi, tu l’amènes, cet ours, de façon magique, et magistrale.
H.P. : J’aime bien l’ambivalence entre l’ours qui est un animal tellement puissant, rapide, invulnérable, qui peut nous tuer d’un coup de patte, et justement ce nounours qui est mignon, confortable, une présence rassurante.
V.C. : Un nounours qui est chou, un mot que tu emploies une fois. Parfois tu emploies des mots d’enfant. On sent que dans ta langue il y a des sauts dans le temps.
H.P. : Ah, moi, je trouve très important, ce n’est pas très original ce que je vais dire, mais je trouve que les enfants ont un rapport immédiat avec le mot : le mot veut dire tout de suite la chose. Et ça, un écrivain essaie de retrouver ça aussi.
V.C. : Je ne trouve pas ça du tout banal, on pourrait traduire en psychanalyse avec Lacan en disant que si pour Hegel, le mot est le meurtre de la chose, l’écrivain cherche à rendre le mot vivant. C’est pour ça qu’il doit un peu tuer la chose.
H.P. : C’est vrai, il faut parfois s’éloigner de la réalité concrète, voire proposer une réalité en concurrence. D’ailleurs, au Moyen Âge, les écrivains étaient suspects aux yeux de certains théologiens parce qu’ils singeaient la création.
V.C. : C’est bien vu, parce qu’en créant certaines choses par l’écriture, tu participes du divin. Celui qui a imité Dieu, c’est le diable.
H.P. : C’est ça, et c’est tellement prétentieux. La réalité est tellement riche, quand on voit tous les animaux, la faune, la flore… pourquoi en rajouter (rire) ?
V.C. : Les mots que tu emploies sont ceux dans lesquels tu as baigné, mais tu cherches à inventer une autre langue, qui te permette de dire que les autres n’entendent pas… Le jeu avec la balançoire, le car postal… Je t’ai suivi, mais tu m’as perdue entre la tireuse de bière et tout l’imaginaire collectif dont on aime bien se moquer : les jeunesses de village… Je trouve dans tes nouvelles quelque chose de Corina Bille, de ce talent-là, mais au XXIe siècle. Dirais-tu que tu as une écriture plutôt féminine ?
H.P. : Non, pas spécialement, ni masculine ni féminine. Mais Corina Bille, ça me touche beaucoup. Elle a quelque chose de magique. Elle réinjecte de la magie sur des environnements à mes yeux très banals, le Valais, la Suisse, notre quotidien. Elle ne cherche pas le spectaculaire.
V.C. : La poésie n’a rien à voir avec le tourisme. Tu as un frère qui vit au Japon, et qui peut trouver au Japon la même banalité qu’ici. Sauf qu’il faut quelqu’un pour la voir.
H.P. : Au-delà de la réaction un peu ennuyée, il faut aimer dans la banalité ce pan de pureté qui a quelque chose de magique, de mystique.
Notes: