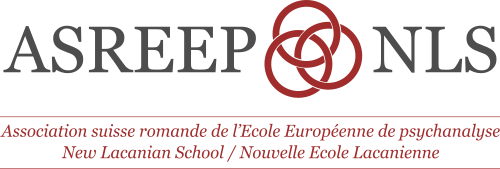La science ou la vie

Conversation avec Boas Erez, le 29 juillet 2025.
Popper, Freud et Jésus
Violaine Clément : Merci à toi, cher Boas, d’avoir accepté cette conversation avec moi et pour l’ASREEP-NLS, à laquelle tu participes dans le cadre du séminaire sur « L’usage des mathématiques chez Lacan ». En regardant la télévision suisse italienne et en consultant d’autres médias suisses, dans lesquels tu apparais surtout en tant que recteur de l’Université de la Suisse italienne, j’ai été frappée du fait qu’on parle de ton charisme. Quand j’ai fait la passe, on m’a affublée lors de ce moment de ce signifiant qui m’a blessée, qui a été traumatique, parce que, pour moi, Hitler aussi avait du charisme (rires). Comment ce signifiant a-t-il résonné en toi ?
Boas Erez : Puisque tu as prélevé ce signifiant dans les interviews et dans des apparitions publiques, je vais donc te donner mon avis sur ces entretiens avec les journalistes. Je ne me suis au fond jamais vraiment interrogé sur ce qu’ils disaient, mais sur ce qu’il était pour moi important de dire : je les laissais dire. Quant à l’association que tu fais avec Hitler… Je me disais que dans leurs bouches, ce signifiant de charisme n’était pas quelque chose de négatif. Dans ce contexte, il ne s’agit pas d’être trop précis. Ce dont tu te rends compte, c’est qu’il est assez difficile de contrôler complètement ton image publique. Les gens projettent beaucoup de choses sur toi, surtout lorsque j’étais recteur, mais ce qui m’intéressait, c’était l’Université. Je me présentais dès lors comme représentant de l’Université et non comme personne. Ce n’était donc pas ma personne qui les intéressait, mais ma fonction de recteur, de représentant des valeurs de l’Université. Je ne faisais d’ailleurs pas vraiment attention aux détails. Je peux te donner un exemple qui montre comment le discours public s’empare de la situation et de ta personne. Au début de mon CV figure le fait que je suis né dans le canton des Grisons. Les CV commencent généralement par cela. Tout le monde pensait alors – et ça leur faisait même plaisir de le croire – que j’étais Grison, que je venais des Grisons, alors que je n’ai passé que deux ou trois semaines dans ce canton. J’y suis né, certes, mais après mes parents ont déménagé et sont retournés à Berne, là d’où ils venaient, où ils s’étaient rencontrés. Je n’ai donc pas grand-chose à voir avec les Grisons et je n’y connais personne. Apparemment pourtant, cela les arrangeait de penser que j’étais Grison.
V.C. : C’était nouveau pour toi de penser que les autres te voyaient autrement que toi ?
B.E. : Ah non, évidemment ! Mais j’essayais malgré tout de contrôler mon image publique, puisque j’avais un métier à faire et parce que c’était dans l’intérêt de l’Université. Je ne pouvais tout de même pas dire n’importe quoi. Et puis c’était aussi une question de tactique. Je sentais que l’Université avait besoin d’être défendue, que le recteur était là pour ça. C’était mon rôle de couvrir certains problèmes internes, en glorifiant les réussites de l’institution, même si je n’y croyais peut-être que moyennement. Quand c’était moi, c’était l’Université, j’étais là en tant que recteur.
V.C. : « Quand c’était moi, c’était l’Université »… J’aime beaucoup cette façon de dire, comme quand Lacan disait : « Moi, la Vérité, je parle ». Quand tu parlais aux médias, tu disais : Moi, l’Université, je parle.
B.E. : Oui, absolument. Ce n’était pas par rapport à la Vérité, mais par rapport à l’Université, effectivement. Ce qui d’ailleurs posait problème, comme cela en pose à tous ceux qui ont des charges publiques et qui veulent, à certains moments, intervenir à titre privé. Tu as beau dire ce que tu veux, tu peux toujours mettre une petite phrase d’explication en avant, les gens n’y croient pas, ils projettent… Ce qui est d’ailleurs souvent une manière de te faire taire… Si tu dis des choses dérangeantes, ils te font rapidement comprendre qu’un recteur ne doit pas se mettre en avant. Cela est malheureusement très habituel en politique. Une fois que les gens sont casés, il faut qu’ils restent dans leur case. Il n’y a que les politiciens qui peuvent s’exprimer sur tout et n’importe quoi, avec une compétence souvent très relative. Il fallait jouer aussi là-dessus. Et je devais donc toujours jouer mon rôle en sachant que mes positions pouvaient nuire à l’institution.
V.C. : C’est très intéressant, parce que tu as dit tout à l’heure que lorsque quelqu’un de la presse t’interrogeait, tu devais parler de façon générale. Or lorsque tu parles dans les 7 minutes de Boas Erez1, ta position est de chercher le détail, d’aller le plus possible au fond des choses. À la fin de l’entretien, tu dis : Je pourrais faire autre chose (que les mathématiques), mais je pense que je le ferais de la même manière. Dès lors le style, la manière Boas, tu pourrais la décrire un peu pour nous ?
B.E. : Plus j’y pense, plus je constate que c’est effectivement ma manière de faire : aller au fond des choses. D’une certaine façon grâce à la psychanalyse, enfin du moins à ce que j’ai compris de la psychanalyse, je me dis aussi que je suis très superficiel. Lorsque les gens parlent, je ne cherche pas le deuxième sens. En italien, il y a un mot très joli, c’est la dietrologia : aller voir derrière… Ils me disent ça, mais en fait, c’est pour dire autre chose… Et moi, si je dis ça, alors évidemment, ils vont me le reprocher… Une autre chose que je dis de moi, c’est que je fais des mathématiques, mais que je calcule très peu. Et même en tant que recteur, quand j’avais des responsabilités. C’est pour cela que je ne suis pas un joueur d’échecs et que je n’aime pas du tout y jouer. Quand je prends des décisions, je ne dirais pas que je le fais par intuition, mais qu’il s’agit plutôt d’un calcul non explicite. Cela part d’une analyse de la situation et d’un sentiment qui m’oriente sur ce qu’il faut faire. C’est d’une certaine façon le kairos. Plusieurs possibilités se présentent et il y en a une que je choisis à un moment donné. Il ne s’agit cependant pas d’utilitarisme à la façon Bentham. Je n’ai jamais vraiment compris cette idée qu’il y a un calcul pour tout. C’est de la supercherie. On peut toujours trouver un calcul, une valeur pour laquelle chaque décision pourrait être la meilleure.
V.C : Mais le calcul, c’est aussi ce petit caillou dans la chaussure. Dans l’analyse, ce n’est pas cela qui t’intéresse. Ma question de départ, qui vient de la curiosité devant ton parcours, c’est ce qui fait que, sans vraiment calculer, si j’ai bien compris, tu te sois tourné, et aujourd’hui de plus en plus, vers la psychanalyse.
B.E. : Pour moi, c’est assez linéaire. Si je regarde en arrière, ça s’est passé comme cela : je faisais des mathématiques à Genève, avec un groupe d’assistants, de physiciens, de mathématiciens, et d’autres… J’ai commencé à faire des mathématiques parce que je voulais faire de la logique. Pour faire de la logique, on peut soit faire de la philosophie, soit des mathématiques. Quand tu sors du lycée, tu ne connais rien aux mathématiques, telles qu’elles se font, la recherche, etc. Bizarrement, je pensais avoir une meilleure idée de ce que c’est de faire de la philosophie, et à tort ou à raison, je me suis dit que j’allais donc faire des mathématiques, parce que je me suis dit que c’était plus difficile à apprendre par soi-même. Tout en continuant à m’y intéresser, j’ai laissé tomber cette idée de faire de la logique quand on m’a montré la beauté de faire de l’algèbre. Mais j’ai toujours été intéressé au côté philosophique, au côté fondement des choses. C’est vraiment quelque chose que j’aime. Et les structures aussi. Mon style en mathématiques : je suis un algébriste plutôt qu’un analyste, et j’aime les structures. Je regarde les situations. En tant que chercheur, je travaillais sur le travail des autres. Le travail académique, c’est cela. Il est très rare que quelqu’un arrive, comme ça, avec quelque chose de complètement nouveau, sur quoi personne n’a encore travaillé. Donc tu travailles sur le travail des autres, et tu essaies d’apporter du nouveau, de faire mieux. Tu peux le faire par abstraction : il y a par exemple cinq travaux qui ont l’air similaires, et tu expliques la structure qu’il y a derrière, qui les rend similaires. Ça, c’est en relation avec cette phrase que tu as citée. Par rapport à la psychanalyse, je m’intéressais à l’épistémologie. Mon intérêt pour l’épistémologie était aussi lié à la question des fondements, parce qu’au début du XXe siècle, il y a eu en mathématiques ce qu’on a appelé la crise des fondements. Il y a eu différentes écoles, l’école hilbertienne, formaliste, l’école intuitionniste… Il y a eu un débat sur la manière de fonder les mathématiques. C’est de là que vient l’intérêt de Gödel pour ses théorèmes, qu’il a ensuite démontrés, pour dire que le programme de Hilbert ne tenait pas. C’est vraiment très important. De là mon intérêt pour l’épistémologie. Il y a les auteurs classiques de l’épistémologie des sciences, l’un d’eux étant Popper. Monsieur Popper ne se prive pas, régulièrement, de taper sur la psychanalyse, sur Adler et donc sur la psychanalyse. C’est pour lui le contre-exemple même d’une science, ou plutôt c’est l’exemple même de ce que n’est pas une science. D’après lui, elle n’est pas réfutable, donc elle n’est pas une science. Il répétait cela tellement souvent que j’ai voulu aller voir : cela m’a rendu curieux. Je suis allé voir, et j’ai commencé à lire les livres classiques de Freud : L’Interprétation du rêve, Psychopathologie de la vie quotidienne, Le Mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient, etc.
V.C. : Tu y es allé tout seul ? C’est cela qui est curieux… Personne ne t’a dit : tu devrais aller lire ça pour réfuter ce que dit Monsieur Popper ?
B.E. : Mais oui, bien sûr ! Après tout, j’étais chercheur en mathématiques, et ce n’était pas pour rien. J’ai donc lu Freud, et trouvé cela beaucoup plus intéressant que Popper. Mais après, j’ai continué à faire des maths. Ça, c’était à côté. D’un certain point de vue, et là, c’est une question d’honnêteté intellectuelle de la part de Popper, il est clair que son objectif n’était pas de détruire la psychanalyse. J’ai lu récemment que ce qu’il avait dans le viseur, c’était le marxisme. Cela ne m’intéresse pas vraiment. Mais dans le texte, il y a une certaine naïveté dans son approche. Je comprends pourquoi il a eu du succès : ça rend des services, ça rapporte gros de dire que quelque chose est une science, ou plutôt de dire d’autre chose que ce n’est pas une science. C’est le débat en cours, qui n’arrête pas, qui a amené au Livre noir de la psychanalyse, qui oppose les adeptes de la psychanalyse à ceux des thérapies comportementales. C’est un peu la même chose, tu vois ? Enfin, moi, je suis arrivé à Freud, et j’ai trouvé cela beaucoup plus intéressant.
V.C. : C’est quoi qui t’a intéressé ?
B.E. : Toujours à partir de mon intérêt pour la logique, je me suis mis à lire Wittgenstein, et sa philosophie du langage. J’avais donc une sensibilité pour le langage, et lorsque tu réalises que la psychanalyse ne parle que de ça, eh bien, voilà… Tu approfondis, et là, évidemment, Lacan ! C’est aussi dû au fait qu’après avoir été aux États-Unis, j’ai eu un poste à Bordeaux. Là, j’ai vraiment pu approfondir, avec des gens qui savaient de quoi il s’agissait, ce qu’était la psychanalyse avec Lacan. Parce que ça, tout seul, c’est compliqué.
V.C. : Et à Bordeaux, tu es tombé dans un bon nid. Mais une petite question : quand tu parles de langue, et de lire Freud, Wittgenstein, Lacan, ta première langue à toi, c’est laquelle ? Ta langue maternelle ?
B.E. Il y a, techniquement, deux définitions. Au sens strict, ma langue maternelle, la première que j’aie parlée, c’est le suisse allemand, mais je l’ai parlé jusqu’à trois quatre ans. Après, mes parents ont déménagé au Tessin, et ma mère a toujours fait un effort pour qu’on parle italien à la maison. Même si avec mon père, c’était souvent l’allemand, et avec son deuxième mari, c’était l’anglais. Moi, je parlais avec elle italien, si bien qu’après un certain temps, je parlais mieux qu’elle, et à l’école, évidemment, c’était l’italien. J’ai suivi toute ma scolarité en italien, sauf quelques classes à l’école maternelle en allemand.
V.C. : Et le patois tessinois, tu le connais aussi ?
B.E. : Je ne le connais pas. Je le comprends, mais je ne le parle pas bien. Je n’essaie même pas, je n’essaie pas de faire vrai. D’ailleurs, à Lugano, ça ne se fait pas. À Bellinzona, c’est très populaire encore. Lugano, c’est la ville, et le reste du Tessin, c’est un peu la campagne. C’est comme ça que les gens le conçoivent. Tu vois cela dans le soutien aux équipes de hockey. Il y a deux équipes : Lugano pour la ville, et Ambri-Piotta pour tout le reste, une sorte d’identification aux paysans, aux gens de la montagne, même s’ils vivent à Bellinzona ou à Locarno, qui sont aussi des villes…
V.C. : Lalangue, que Lacan écrit en un mot, on pourrait dire que pour toi qui es polyglotte de naissance…
B.E. : Non, pas de naissance… Enfin oui, si on veut, parce que mon père, sa langue maternelle, c’était l’hébreu.
V.C. : Et l’hébreu et le suisse allemand ?
B.E. : Le yiddish ! Effectivement, avec mes grands-parents, je pouvais parler allemand. Ils parlaient entre eux le yiddish, leur origine était polonaise. Ils habitaient dans les pays sous protectorat anglais, ils se sont trouvés là. Mon père est né là en 1935. Oui, effectivement, le yiddish et le suisse allemand, si on veut. Mais moi, je ne comprends pas le yiddish, je comprends beaucoup mieux le suisse allemand.
V.C. : Avec ce que Lacan nous a apporté avec le concept de lalangue, il y a ce quelque chose qui n’a pas de sens, et qui résonne. Mon petit-fils de près de deux ans, quand il me chante sur tous les tons « Je t’aine », en réponse à mes « Je t’aime », ne sait pas plus ce qu’il dit que moi, mais on s’amuse…
B.E. : Je crois comprendre ce qu’est ce concept de lalangue, dont j’ai des exemples chez moi… Quand les mots n’apparaissent pas dans le discours : il faut les découper.
V.C. : C’est donc un effort constant pour tenter de les découper, pour croire qu’on sait ce qu’on dit quand on se parle, ainsi entre toi et moi… En lisant tes textes et en t’entendant tout au long de ce séminaire sur « L’usage des mathématiques chez Lacan », je me suis dit que c’est quand même très rare, que tu es peut-être un spécimen unique pour arriver à nouer pareillement la mathématique, au sens grec de l’enseignement, à la psychanalyse. C’est précieux ce que tu fais. Mais as-tu l’idée maintenant, dans la poursuite linéaire de ta carrière, de continuer à faire de la recherche, en psychanalyse ?
B.E. : Pas jusqu’à récemment, il y a quelques mois seulement. C’est là que j’ai commencé, me semble-t-il. Finalement je me suis dit que c’est exactement comme ça que je l’ai dit dans cette conversation de sept minutes, qui n’en sont pas 7, c’est qu’en fin de compte, je me rends compte qu’en tant que mathématicien, ce que je faisais, c’est exactement ça, c’est ce que j’ai dit : c’est lire les textes d’autres personnes, et les élaborer, dans un souci de rigueur. Tu sais, si tu as suivi le séminaire à Lausanne, que je considère que la rigueur, c’est l’objet des mathématiques. Et partant du fait que Lacan disait de lui-même qu’il était rigoureux (V.C. : Et donc psychotique !), un peu psychotique (V.C. : Il n’en fait pas une insulte), c’est juste un trait. Il a un trait commun, et justement, c’est une question de précision. Partant de cet effort de rigueur, je me dis, c’est une sorte de conjecture, un énoncé, pas une démonstration. Partant de là, comme Lacan l’a été en psychanalyse, c’est donc nécessaire que tu tombes sur des formulations mathématiques. Mon projet de recherche est de faire un chemin très proche du chemin que j’ai fait en mathématiques, je l’appelle : « Formulations de la psychanalyse ».
V.C. : Ah ! Au pluriel ?
B.E. : Oui, évidemment ! Si j’étais un peu plus jeune, le projet de recherche serait, après la psychologie lacanienne, d’aller par exemple voir chez Bion.
V.C. : Bion, c’est la question du groupe. Et toi tu es toujours en train de chercher comment tenir tout seul, mais pas sans le groupe. Et même si le groupe n’est pas là, tu continues à tenir tout seul, c’est aussi ce que Lacan a inventé avec le cartel. Une autre de ses idées de génie, de faire que chacun mette sa question au travail, pas sans quelques autres, mais dans l’idée qu’il produise tout seul. Si tu étais plus jeune, demanderais-tu au Fonds national d’ouvrir un fonds de recherche qui ferait venir des gens de différents mondes ? Lacan, dans son Séminaire XII (p. 75), nous donne une indication que je suis en train de travailler avec un universitaire spécialiste de Virgile sur les deux portes par lesquelles Énée revient des Enfers avec la Sybille. La porte par laquelle il passe est celle d’ivoire, celles des falsa, des mensonges. Ce qui est génial, c’est que cette question reste irrésolue pour les philologues eux-mêmes. C’est une énigme que Lacan balance à la fin d’une leçon en nous proposant, comme à des abeilles, d’aller faire notre miel là-dessus ! Ta manière de nous mettre au travail a quelque chose à voir avec ça. On a envie, d’abord de te contredire, mais il faut pour cela se lever tôt, et d’aller chercher un peu plus. Toi, tu as le bagage mathématique. Mais chacun a un autre usage de la langue, un autre rapport au savoir. Qu’est-ce que tu as trouvé intéressant, toi, dans ce séminaire ?
B.E. : En mathématiques, la plupart des articles sont signés par une seule personne, et les gens pensent qu’on travaille tout seul, contrairement à ce qui se passe en biologie, ou même en physique. Ce qui n’empêche qu’il y a eu, même en mathématiques, des collaborations importantes. Moi-même, le meilleur de mon travail, c’est un travail que j’ai fait avec trois autres collègues, un Anglais, un Américain et un Grec établi aux États-Unis. À quatre, nous avons produit une série d’articles, fidèles au principe mis en évidence par un des membres d’un couple fameux, le couple Hardy et Littlewood, et qui a été vérifié dans les témoignages de mathématiciens connus, comme Armand Borel. Parler à quelqu’un suffit à te faire avancer. Ainsi, Hardy et Littlewood signaient les papiers ensemble, même si l’un des deux n’avait eu aucune idée qui apparaît dans le papier. (V.C. : C’est formidable, ça !) Parce qu’ils reconnaissaient que c’est le fait qu’ils discutaient qui faisait que l’un d’eux avait des idées, avançait sur un sujet. Après, il y a une répartition des rôles un peu plus technique, soit que l’un écrivait mieux que l’autre, ou qu’il était plus soigneux, que l’un avait intérêt à le faire, que l’autre était un peu plus exubérant. L’un faisait la rédaction, mais ce n’était pas pour autant le nom de celui-là qui signait. C’est pour cela qu’on cite souvent les grands mathématiciens, parce qu’on a le sentiment d’avoir appris quelque chose de… leur écoute. Borel, un grand mathématicien suisse, disait que les gens venaient le voir, et qu’il avait simplement la gentillesse de les écouter ; et ça donnait quelque chose…
V.C. : C’est le principe de l’analyse !
B.E. : Oui ! Bien sûr, mais bon… On ne vient pas chercher des idées en analyse. La première chose que m’a apportée le séminaire, c’est cela. Il ne faut pas mal le prendre : j’avais un mur auquel je parlais, un mur très qualifié ; le fait qu’il y ait une écoute, fait que je ne peux pas dire n’importe quoi, c’est très important. Par exemple, dans la préparation du séminaire, je discutais de temps en temps avec Dominique Rudaz, et comme il a son approche à lui de l’analyse, il m’a quand même amené des choses, et il y a eu les commentaires de François Ansermet, ou des autres, et les questions, c’est quelque chose qui est non seulement utile, mais nécessaire pour avancer. Quand j’étais à Bordeaux, j’ai pu faire beaucoup de travail. Mais comme tu le dis, après, c’est ma production.
V.C. : Tu n’as jamais fait signer par l’ensemble… Ce que Lacan a fait…
B.E. : Non, effectivement, après, si c’était Lacan qui signait, beaucoup ne signaient pas, ou si ce que je produis apparaissait dans une revue dans laquelle personne ne signe ses articles, parce que, de toute façon, c’est lacanien, ce ne serait pas faux non plus. Même si chacun amène sa propre marque, il y a quand même une élaboration.
V.C. : Quand tu parles dans cet entretien avec Studio Lacan2, tu as rappelé que Lacan avait une vision très mathématique du monde, et qu’il avait bien saisi ce qui se passait dans les avancées mathématiques. Toi, tu peux le dire, parce que tu as ce niveau en mathématiques, mais Lacan a été très décrié, y compris dans son champ. On a pensé qu’il avait perdu la boule avec ses nœuds de ficelle… Et toi, tu dis non, pas du tout !
B.E. : Oui, j’en suis persuadé. Et en plus, c’est pareil dans un tas d’autres domaines. Je ne sais pas ce que va te dire le spécialiste de Virgile que tu vas inviter, mais Barbara Cassin le dit très explicitement à propos des discussions qu’elle a eues avec lui autour des sophistes. J’ai quelque part la référence d’un article d’un spécialiste de la Préhistoire qui dit pareil que les conjectures de Lacan sur l’homme primitif, sur le trait unaire, c’est tout à fait pertinent. Les joyciens, c’est pareil. Lacan avait pour Joyce une passion de jeunesse. Je ne sais pas si c’était aussi le cas pour les mathématiques, mais depuis toujours, ou du moins depuis les années 40, il s’est intéressé sérieusement aux mathématiques. Et pour moi, de parler avec des mathématiciens professionnels, c’est d’une part respecter le savoir-faire, la connaissance, et d’un autre côté, c’est pratique, parce que lui, ce qu’il veut, c’est avancer. J’ai lu qu’il était assez impatient, qu’il voulait avancer vite. Alors évidemment, de poser directement la question à quelqu’un qui sait… Ça ne devait pas être très agréable de discuter avec lui si tu n’étais pas prêt, parce qu’il voulait des choses, il voulait extraire des choses. Mais toujours avec une capacité d’élaboration, de compréhension, une capacité à extraire des choses. Il est toujours très juste, même par rapport aux personnes qu’il critique. Il leur trouve des excuses dans le monde symbolique où ils étaient, parfois avec ironie. Il peut être très dur, dans les séminaires, sans être jamais malpoli. J’en suis persuadé, pour avoir fait quelques exercices, comme je le disais, c’était très important pour lui, et il faisait les exercices, ou il les refaisait, ou on lui avait expliqué comment faire, et il refaisait. Après, le mystère, lorsque les gens disaient qu’il perdait la boule, ça devait être désagréable de participer à ses séminaires, alors qu’il ne disait plus rien. Pendant des années, tu avais eu l’habitude d’aller à ses séminaires, et il te servait des histoires, que la psychanalyse, ça a à voir avec ci, et avec ça… et tout à coup, il passe son temps au tableau à faire des nœuds, et puis il se trompe… C’est exactement ça qu’il faut faire, il faut se tromper. Je ne sais pas si j’ai lu ça dans un texte de Miller, qui note qu’il a dit : « J’attends, mais je n’espère pas ». Si tu veux, quand tu attends, quand tu es impatient, tu peux t’attendre à ce que les choses arrivent, et elles arrivent quand même. C’est ça qui est assez incroyable. C’est pareil en mathématiques : il y a des gens qui ont tout le temps une inspiration, des gens beaucoup plus productifs que d’autres. Il y a un mathématicien très influent de la fin du XXe siècle, Spencer Bloch, un Américain qui travaille dans un domaine dans lequel est arrivé un certain moment, un Japonais, pas beaucoup plus jeune que lui, Kazuya Kato, qui avait créé un programme de recherche, et qui avançait au pas de marche. Les deux étaient très productifs, mais l’un disait de l’autre, je ne me souviens plus qui des deux : je ne sais pas comment il fait, mais on est tous là, la bouche ouverte vers le ciel, pour que les étoiles tombent dedans, je ne sais pas si lui a une bouche beaucoup plus grande, ça n’en a pas l’air (rire), mais tu vois, il attrape quand même beaucoup plus d’étoiles. C’est vraiment de l’ordre du mystère. Lacan, je pense, n’a pas dû attendre trop longtemps, et je pense que peut-être, à la fin, c’est un peu cela qui se passait. Il aurait pu laisser tomber les nœuds, tu vois, indépendamment de la question de l’âge, il aurait pu bifurquer sur autre chose, mais il devait sentir que c’était là, que c’était quelque chose qui était là, et qui n’allait pas. Et donc il attend…
V.C. : Cette question du mystère, qui rejoint aussi celle des grands mystères d’Éleusis, et celle de l’énigme, rejoint aussi pour moi celle de la croyance, de la foi. J’ai lu aussi que tu avais été baptisé (B.E. : Oui !), il n’y a pas très longtemps, d’après ce que j’ai compris ? (B.E. : en mai 2021). Tu es chrétien depuis 4 ans ?
B.E. : Oui, tout à fait ! Cela m’amusait d’ailleurs quand je suivais le catéchisme ; autour de moi, il y avait des enfants d’amis à qui je disais : oui, tu vois, moi aussi, je suis tout petit, d’une certaine manière (rire).
V.C. : C’est drôle, parce qu’hier, j’avais un baptême, au fin fond du Valais, et en fait il s’agissait de deux baptêmes, par un prêtre polonais, et j’étais la marraine de la maman de deux petits Anglais… Je relie cela aussi à la tradition, à la mathématique. Tu serais d’accord de nous en dire un peu plus, sur ce rapport à la foi, en lien avec la mathématique et la psychanalyse ?
B.E. : Là, comme ça, je n’ai jamais pensé que ça pouvait avoir un rapport avec la mathématique. C’est plutôt du côté de… Moi, j’ai toujours fait les choses de manière sérieuse, donc de manière sérielle. Je reviens dessus, je fais les choses les unes après les autres. La psychanalyse était au départ un intérêt purement intellectuel. Tu vois, Popper écrit sur la science, c’était mon monde, Freud parle de la vie (V.C. : la science ou la vie !), d’une manière un peu particulière. Je me suis ouvert à la variété du genre humain, si on peut dire, avec la psychanalyse, et à un certain moment, je me suis ouvert à la spiritualité, mais en venant de la psychanalyse. Tu peux voir cela du point de vue psychanalytique, en te mettant en position d’analysant. Mon père était très croyant quand il était jeune, ma mère s’est convertie au judaïsme au moment du mariage avec mon père, mais elle n’a certainement pas vécu ça comme une contrainte, au contraire. Je pense qu’un des charmes de mon père, c’était qu’il venait de cette tradition, judaïque.
V.C. : Donc par amour ? L’amour était une conséquence de la religion, et inversement…
B.E. : Je ne sais pas, disons que c’était un élément, je ne connais pas le détail, dans l’intimité. Mais c’est clair que c’était quelque chose qui l’intéressait elle aussi. Lui était porteur de cela. Après il l’a déçue, parce qu’il a complètement laissé tomber ça, il a coupé les amarres avec Israël. Si je m’appelle comme je m’appelle, enfin mon prénom, c’est parce qu’ils avaient le projet de s’établir en Israël, et je pense que mon père, essentiellement, a décidé que non, qu’ils n’allaient pas faire cela. Parce que lui est venu en Suisse avec une bourse d’études, et il aurait très bien pu repartir là-bas. Eh bien, non. Ça a dû être une sorte de déception pour ma mère. Et puis l’approche de la religion juive était quelque chose que j’ai toujours vécu de façon artificielle. Cela passait par ma mère, qui avait appris cela dans les livres.
V.C : Ta mère s’occupait de vous transmettre la religion juive.
B.E. : Bien sûr ! Comme je disais, j’étais techniquement juif, parce que ma mère est juive. (V.C. : Pas scientifiquement ?) Non, techniquement. Enfin, je te dis ce que je disais, que ce soit fondé ou non. Ce n’était pas scientifique, mais technique, au sens où tu vérifies certaines conditions, et si ça marche, il l’est. J’étais juif par définition, pour tout ce qui était la tradition : j’ai été jusqu’à faire la bar mitzvah, à 13 ans. Et puis j’ai baigné au Tessin dans un monde catholique. Je suivais de loin les enseignements, je voyais autour de moi ce que ça faisait. Une fois que j’ai eu cette ouverture sur le monde spirituel, j’ai élargi encore ma curiosité sur le genre humain à cette composante, j’ai trouvé cette formule, qui traduit assez bien mon sentiment : j’ai arrêté de résister. J’avais toujours un attrait, une curiosité pour ce genre de chose.
V.C. : Serais-tu d’accord qu’on s’arrête sur cette formule : j’ai arrêté de résister ?
B.E. : Si tu veux… Une fois que tu es ouvert à la spiritualité, tu te demandes comment la traduire en pratique. J’aurais pu rester juif (rire).
V.C. : Quelle formule !
B.E. : Mais vraiment, j’ai pris la chose au sérieux.
V.C. : Comme toujours, tu restes dans les fondements.
B.E. : Et les mots de Lacan, qui disait que c’était la vraie religion, pas seulement la seule, c’étaient des mots qui m’avaient travaillé bien avant. Je le comprends comme cela : du point de vue de la spiritualité, pour parler des religions que l’on connaît, avec lesquelles on a des accointances, c’est la question de la présence de Dieu. Tant que, comme chez les Juifs, Dieu est transcendant, jamais là, ça fait un certain type de religion, un certain type de relations. L’incarnation et la trinité affrontent vraiment la problématique, sérieusement. Ce n’est pas parce que j’aime les choses compliquées, mais ce n’est pas simplement dire : il est là, oui, mais il n’est pas là. Il est venu, et c’est cela qui m’intéresse.
Notes :
- « Les 7 minutes de Boas Erezh » (Youtube). ↑
- « De quelques références mathématiques de Lacan, avec Boas Erez » (Youtube). ↑