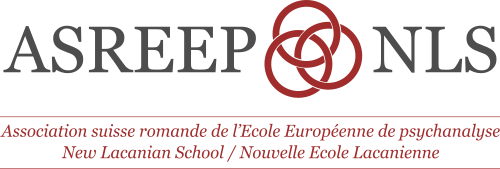Sono…

Conversation avec Omar Battisti, par Violaine Clément. 16 avril 2021.
Violaine Clément : Je suis très contente de converser avec toi, cher Omar, chacun dans sa langue, pour apprendre de toi comment les choses se passent en Italie, pour les jeunes plus particulièrement, comment la psychanalyse continue, et quelque chose de cette question des trans, à laquelle nous convoque Jacques-Alain Miller… Tu as carte blanche pour dire ce que tu veux…
Omar Battisti : Merci à toi, Violaine. Cela me plaît de faire conversation, et je vais donc partir de cette question des jeunes. Je travaille comme éducateur en milieu scolaire, depuis quelques années, et c’est en somme mon activité principale. Dès mars de l’année dernière, tout a radicalement changé pour moi parce que les jeunes dont j’avais la responsabilité n’ont pas eu la possibilité de fréquenter l’école. Toutefois, j’ai eu la possibilité de faire avec eux un travail plus personnalisé, de leur garantir un travail plus individualisé. Je n’ai donc pas eu la possibilité de les rencontrer en présence (in vivo), mais il devenait possible de mettre en place quelque chose d’un autre registre, par le téléphone, le computer… à partir du travail effectué auparavant avec eux à l’école.
V.C. : Quels enfants ont droit à ces aménagements ?
O.B. : Ce sont des enfants qui ont des diagnostics, et pour lesquels des protocoles prévoient qu’ils doivent avoir un enseignant de soutien pour leur permettre de fréquenter la classe, mais avec des attentes particulières, car en Italie il n’y a pas d’écoles spéciales, et tous les enfants doivent aller à l’école publique. Je ne sais pas en Suisse, mais je pense qu’il y a quelque chose de semblable pour les enfants accueillis à l’Antenne 110, ou au Courtil. En Italie, par exemple à l’Antennina di Venezia, les enfants fréquentent l’école publique.
V.C. : Combien d’heures peux-tu suivre ces élèves par semaine ?
O.B. : Question difficile, mais intéressante paradoxalement, car le principe de l’inclusion doit être abordé avec grand soin. En pratique, partant d’un désir de civiliser, l’inclusion peut devenir un idéal très féroce, dans le sens de ne pas donner la parole au sujet, et de réduire toute la question d’être avec les autres ou de ne pas être avec eux, rendant forclose toute la question de l’insupportable de la présence de l’autre pour ces enfants, de l’insupportable de leur propre corps. Cette dimension pulsionnelle qui fait l’intime de chacun, et qui peut être très liée à l’insupportable, peut, avec le risque de l’inclusion, comme un idéal féroce ne voulant rien en savoir, aboutir à une violence, une violence parfois terrible.
V.C. : Cela ouvre la question de la psychanalyse, dans un champ qui n’est pas le cabinet.
O.B. : En effet, dans ce contexte, je ne suis que l’éducateur, mais pas sans l’expérience de ma propre analyse personnelle, et celle des contrôles avec l’analyste avec qui je pose les questions que me pose le cas. La psychanalyse est donc présente, comme le dit di Ciaccia, sans être là, puisqu’elle m’oriente. C’est avec la boussole de l’insupportable que je travaille. La difficulté est de faire tourner non pas la vérité, mais la pratique.
V.C. : Se pose dès lors la question du transfert pour ces jeunes qui n’ont pas choisi de travailler avec toi.
O.B. : Exactement. Je voudrais rendre hommage à Virginio Baio qui a été un maître parce qu’il m’a enseigné dans ses textes quelque chose qui a été pour moi un enseignement quotidien. Il a publié sur Appunti un texte intitulé : Une parole sans demande. Je trouve que dans ma pratique dans l’institution publique – qui n’est pas ce que Jacques-Alain Miller a appelé institution sujet -, met à l’épreuve que l’orientation analytique peut nous servir là où il n’y a aucune demande. La personne qui s’y trouve n’a fait aucune demande, en particulier, il s’agit de mettre en jeu, de manœuvrer ma présence de manière à ce qu’elle ne soit pas persécutoire, ni féroce, afin de permettre à celui qui est aux prises avec l’insupportable de ne pas être mis à mal. Plutôt que de m’apprendre quoi faire, la psychanalyse m’a appris ce que je ne devais pas faire, mais juste à être là.
V.C. : Très juste ! Cette position de personne, ne pas demander, ne pas vouloir, savoir être juste là. D’autant plus délicat dans ces temps de COVID.
O.B. : Oui ! Au début, en mars 2020, je n’avais pas d’autre ressource que le computer pour travailler. Dans cette situation, je me suis demandé si je pouvais faire quelque chose pour cette personne avec qui je travaillais avant en présence. Je dois dire que pendant ce temps où nous travaillions ensemble par computer, je cherchais à être là, avec lui, qu’il ne soit pas sans Autre. Ce temps est un temps attendu. Il s’agit de tenir quelque chose par ce travail qui, sinon, serait rompu. Pendant le premier confinement, un téléphone d’une heure avec le garçon avait aussi cette visée de ne pas interrompre ce qui sinon se serait interrompu. Avec les moyens actuels, il n’y a pas la présence directe, les corps.
V.C. : C’est la question de la présence-absence qui se lit là dans ce « ne pas interrompre ». As-tu l’impression que ce que tu fais est nouveau ?
O.B. : Absolument, c’est quelques chose de nouveau, d’inédit, au sens où je ne me serais jamais imaginé mettre en jeu quelque chose de ce lien imaginaire avec l’autre, de cet espace non partagé. C’est un lien qui passe à travers une conversation, comme nous le faisons actuellement.
V.C. : Notre rencontre s’est faite aussi par ces moyens, et si le monde avait continué sans le COVID, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. As-tu mis en place, imaginé quelque chose qui pourrait durer, même après le COVID ?
O.B. : Oui, ce qui est d’une part une difficulté peut aussi être une opportunité. Quelque chose de ce qui s’est produit dans cette rupture pourrait avoir de nouvelles incidences. Ainsi lorsque je suis retourné pour une journée à l’école avec un garçon que je ne voyais plus que par le computer, il s’est produit là quelque chose qui m’a beaucoup interrogé sur ce que veut dire être là, à partir de l’espace que j’occupais. Je me suis mis à interroger l’espace que nous partagions avec nos corps, la proximité et la distance, le rapprochement et l’éloignement. C’est quelque chose dont parle Miller dans L’érotique du temps, comme d’un circuit qu’il s’agit de faire, parce que l’espace libidinal ne se traverse pas de manière linéaire, d’un point à un autre. Ma formation est celle-là. Mon style, que j’ai pu mettre au travail sur le divan, va au-delà de la place d’où j’opère. Pour renverser la question, l’obstacle rencontré dans cet espace libidinal est quelque chose qu’il serait important de maintenir, de mettre au travail, et non pas de l’éjecter, de faire semblant qu’il ne s’était rien passé.
V.C. : Se servir de l’obstacle, de ce caillou sur lequel on bute, c’est le pari de la psychanalyse, de considérer que ce qui nous empêche donne lieu à une nouvelle création.
O.B. : Pour le dire avec ce qui m’est arrivé, j’ai eu le Covid, certes pas dans sa forme la plus grave, la plus invalidante. Mais ça a été l’occasion de vivre à nouveau une angoisse que je n’avais plus rencontrée depuis longtemps, et que j’ai pu mettre au travail avec mon analyste, par les moyens télématiques. Cet obstacle a ainsi été un point d’avancée pour moi, pas sans l’Autre !
V.C. : Je lis actuellement Némésis de Philip Roth, qui parle de la pandémie de polio qui a dévasté Newark dans son enfance, où il parle de la transmission de la maladie. Cela -t-il été une question pour toi sur la culpabilité, de comment tu l’avais attrapé, à qui tu l’avais transmis, pour toi est-ce une question ?
O.B. : Je dirais simplement que la dimension la plus angoissante a été la séparation de mes proches, et je dirais aussi la question de la parole même, qui porte avec elle quelque chose de l’intime et de mortifère. C’est là qu’il s’agit d’insérer cette angoisse, pas tellement dans cette question de la transmission du virus, mais dans quelque chose de très réel, de très physique, qui est surtout cause d’une séparation concrète, réelle, qui réduisait le corps à un organisme. J’ai été touché par ce que Lacan dit quand il nous dit que nous sommes réduits à notre corps propre.
V.C. : J’ai appris que ces derniers temps, on a découvert des vaccins contre le sida, mais qu’on en parle peu, la transmission du sida ayant un lien très fort avec la culpabilité, qui s’enclenche un peu moins avec le COVID. Ce que tu dis sur le corps, et sur les proches, c’est quelque chose qui est présent, en effet.
O.B. : Pour le dire ainsi, la question qui est en cause est celle de ce qu’est un corps, un corps vivant, jouissant, en tant qu’il existe, en lien avec la question du temps. La question du temps éternel, dont Lacan parle ainsi dans le Séminaire XXIII : “Il faut essayer se de se dépêtrer de l’idée d’éternité”1. Ce sont des choses que cette époque nous enseigne. L’éternité est un fantasme, comme Miller le dit dans son tweet tout récemment, en parlant de l’anniversaire de Lacan, et que j’ai trouvé formidable. Il parle de la question de la postérité, dont Lacan disait que c’était un fantasme, qui met en cause le corps comme quelque chose d’indéfinissable, de profondément lié à la vie.
V.C. : Dans un commentaire à un cas de Jean-Claude Maleval, Miller parle ainsi de ces quelques minutes de plaisir. « Quand vous allumez une cigarette, vous programmez trois minutes de plaisir et vous tenez dans la main un morceau de temps. L’effet désangoissant de la cigarette consiste précisément à vous assurer un pont dans l’abîme temporel que l’on a vu se creuser »2. Comment attrapes-tu toi ces trois minutes de plaisir, toi qui fais du jazz ?
O.B. : Génial ! Pour moi, qui ne suis pas fumeur, ce n’est pas trois minutes. Mon temps, quand je suis dans mon cabinet, je me prends un moment dans la journée où j’éteins la caméra, et je peux aller ailleurs. C’est là que j’ai la possibilité de jouer, ce qui est pour moi un jeu, comme on le dit dans toutes les langues, to play, suonare, spielen. L’activité ludique est primordiale. Je me vois alors transporté là où je sais que je ne peux aller. L’improvisation est quelque chose de formidable, qui te met face à une autre dimension du temps, quelque chose qui est de l’ordre de la contingence, ça peut arriver, ou non.
V.C. : Tu peux le faire tout seul ?
O.B. : Oui, mais cela m’est arrivé de pouvoir jouer avec d’autres, ce « con », en français « avec », dont Lacan parle dans le Séminaire XXIII 3.
Il m’est arrivé de jouer avec quelques personnes, sans que ce soit prévu, c’était au cours d’un séminaire, il y a quelques années, et ce fut pour moi un événement inoubliable ; c’était justement durant les quelques 3 minutes de pause, et je me suis mis à accompagner à la guitare celui qui avait commencé à jouer, et puis un autre s’y est mis aussi, et sans le savoir, sans le vouloir, comme en anticipation, se sont produites cinq minutes de musique tout à fait inattendues et inédites. Il y avait là du jouer seul, mais pas sans l’autre !
V.C. : C’est aussi cette idée qu’on retrouve les cartels de l’École, chacun joue seul, pas sans l’autre. En français, la connerie, c’est aussi avec le « con », ça a à voir avec l’Unbewusst…
O.B. : Ah oui, j’ai compris… Pas seul, mais pas sans l’autre, c’est ce qu’on trouve dans le Champ Freudien, et peut donner beaucoup de goût à faire les choses.
V.C. : Comme avec le jazz, ce pari peut réussir, ou pas… C’est le pari de la conversation. Alors, chez vous, à Rimini, comment les choses se passent-elles aujoud’hui ?
O.B. : Nous, à Rimini, si je peux dire nous, continuons à faire les choses. Pour ma part en tout cas, je continue à faire cartel avec les moyens informatiques, et il y a des activités qui se développent au niveau national, et au niveau local. Ainsi aujourd’hui, par exemple, nous nous retrouverons à Turin où une rencontre est prévue, par zoom, avec Miquel Bassols. Je trouve important que cette possibilité qui nous est offerte ne soit pas rejetée après le COVID, quand arrivera l’après COVID. C’est une chose qui m’a enthousiasmé l’année passée, de pouvoir participer par Zoom à des rencontres avec des musiciens sud-américains. Le jazz est l’autre de mes deux passions fondamentales, la musique et la psychanalyse. J’ai pu participer à ces rencontres, ce qui était pour moi nouveau. C’est clair qu’il y a des limites, mais je pense que pas tout de ces rencontres on-line ne doit être rejeté…
V.C. : C’est maintenant, après une année, qu’on se rend compte de la grande fatigue que représente ce mode de rencontre, où nous sommes accrochés à la vision en oubliant le reste du corps. Il faudra trouver un nouvel équilibre…
O.B. : C’est la question de la bascule, que je suis en train de travailler autour de la question des trans. C’est quelque chose qui a à voir avec la manière qu’a chacun de dire aujourd’hui : Je suis… Je suis trans, je suis gay, je suis superman ou … Cette dimension de l’être fait couple avec quelque chose qui fait obstacle à la vie. C’est quelque chose de la pulsion de mort qui vient et qui porte au pire. Et la bascule a à voir avec la position de l’analyste, d’être là, d’exister, et dont la part essentielle a à voir avec l’association libre, c’est-à-dire à parler, à dire. Ça m’intéresse de travailler sur une autre dimension de l’acte analytique, qui fasse couple, entre les pulsions de vie et les pulsions de mort, quelque chose que j’ai trouvé bien dit par Davide Pegoraro, lors d’une rencontre4 dans les premiers temps. Il interrogeait à partir de Miller, L’un tout seul, la dernière phrase, où il parle de l’être et du désir de l’analyste. « La position de l’analyste, lorsqu’il se confronte au Yad’lun dans l’outrepasse, n’est plus marquée par le désir de l’analyste, mais par une autre fonction qu’il nous faudra élaborer par la suite »5.
Il parle de l’intervention de l’analyste, de sa présence, donc de l’acte, qui n’est pas réductible au désir de l’analyste, mais qui met en cause la fonction du trou, et qui, je crois, a à voir avec le vide, et l’énergie qui s’y trouve. C’est ce que dit aussi Marie-Hélène Brousse en parlant du trou noir dans son dernier livre.
V.C. : Cette question du Sono, dont on a aussi entendu parler par Anna Aromi lors de la précédente conférence par zoom à Turin, a en effet à voir avec les trans. Cet auto engendrement par le dire est quelque chose de moderne, et que vous dites très bien, en Italie, autour de la question du congrès sur le réel du sexe, qui est un dire. Il y a une dimension sur laquelle vous insistez et que j’ai aussi constatée dans le cadre scolaire, ainsi cette jeune fille qu’on m’avait adressée parce qu’elle ne voulait pas s’inscrire sur les formulaires officiels ni comme homme ni femme, et à qui j’avais demandé si elle aurait accepté de s’inscrire s’il y avait eu une troisième option ; elle m’avait répondu finement : Pas sûr ! (rires)
O.B. : C’est ça qui m’interroge dans ce dire : Je suis trans. Il me semble qu’il y a quelque chose qui touche chaque être parlant dans le contemporain, dans le fait que le mariage entre le capitalisme et la science, comme le dit Lacan, met en jeu une réduction du sujet. C’est pour ça que le sujet, mis hors-jeu du discours, revient sur la scène avec cette certitude : Je suis. Ce dire est irréfutable, comme le dit Francesca Biagi-Chai sur Lacan Web TV, qui le contraint à ne rien pouvoir dire d’autre que ça : Je suis, je suis, je, je suis… sans rien d’autre… Un je suis fondamental.
V.C. : Alors qu’en psychanalyse on cherche la réponse à cette question : qui suis-je ? C’est la question qu’on pose au psychanalyste. Mais là, les sujets viennent déposer leur réponse : je suis… Ils n’ont pas forcément une demande, comme tu le disais, mais un impératif. Ils veulent être reconnus, mais sans savoir comme quoi…. Après le je suis, on pourrait mettre des points de suspension.
O.B. : Exactement, il s’agit d’écrire ces points de suspension qui permettent de solliciter un vouloir en savoir quelque chose de ce qui fait mal, de ce qui fait jouir.
V.C. : Quelque chose qui fasse jouir. Nous avons fait un joli tour, et ta dernière phrase pourrait être le titre… Sono… avec les points de suspension.
O.B. : Absolument !
V.C : Ok pour le titre ; et pour l’image ? quelque chose avec la musique ?
O.B. : Me revient ce souvenir formidable d’un festival où j’étais allé avec ma femme, et je me suis mis à jouer d’une guitare fabriquée par un luthier, avec son autorisation, et je me suis mis près de son magasin, devant les gens qui passaient là… Et les gens se sont arrêtés pour m’écouter, ce dont je ne m’étais pas rendu compte.
V.C. : Très bien, on mettra cette image. As-tu quelque chose de plus à dire ?
O.B. : Non, sinon que dans ce titre, les points de suspension laissent de la place pour que quelque chose de nouveau se dise… du fait qu’il y a toujours quelque chose qu’il manque à dire.
V.C. : Magnifique ! Merci à toi et rendez-vous ce soir par Zoom à Turin !
Notes :
- Jacques Lacan, Séminaire XXIII, Seuil, p. 148.
- Situations subjectives de déprise sociale, sous la direction de Jacques-Alain Miller, Navarin, 2009, p. 168.
- Jacques Lacan, Séminaire XXIII, Seuil, p. 126 (dans la version italienne, p.123) : « Si le truchement, autrement dit l’instrument dont on opère pour la copulation est bien à mettre au rancart, comme c’est patent, ce n’est pas du même ordre que ce dont il s’agit dans mon grand S, parenthèses grand A barré. Le grand A est barré parce qu’il n’y a pas d’Autre, non pas là u il y a suppléance, à savoir l’Autre comme lieu de l’inconscient, ce dont j’ai dit que c’est avec ça que l’homme fait l’amour, en un autre sens du mot avec, et c’esr ça, le partenaire – le grand A est barré parce qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre. »
- La présence de l’analyste, deuxième rencontre organisée par la SLP, de la série : La pratique analytique et son orientation lacanienne, le 14 juin 2020, par Zoom.
- Jacques-Alain Miller, L’être, c’est le désir, Le Rêve, XII Congrès AMP, 2020